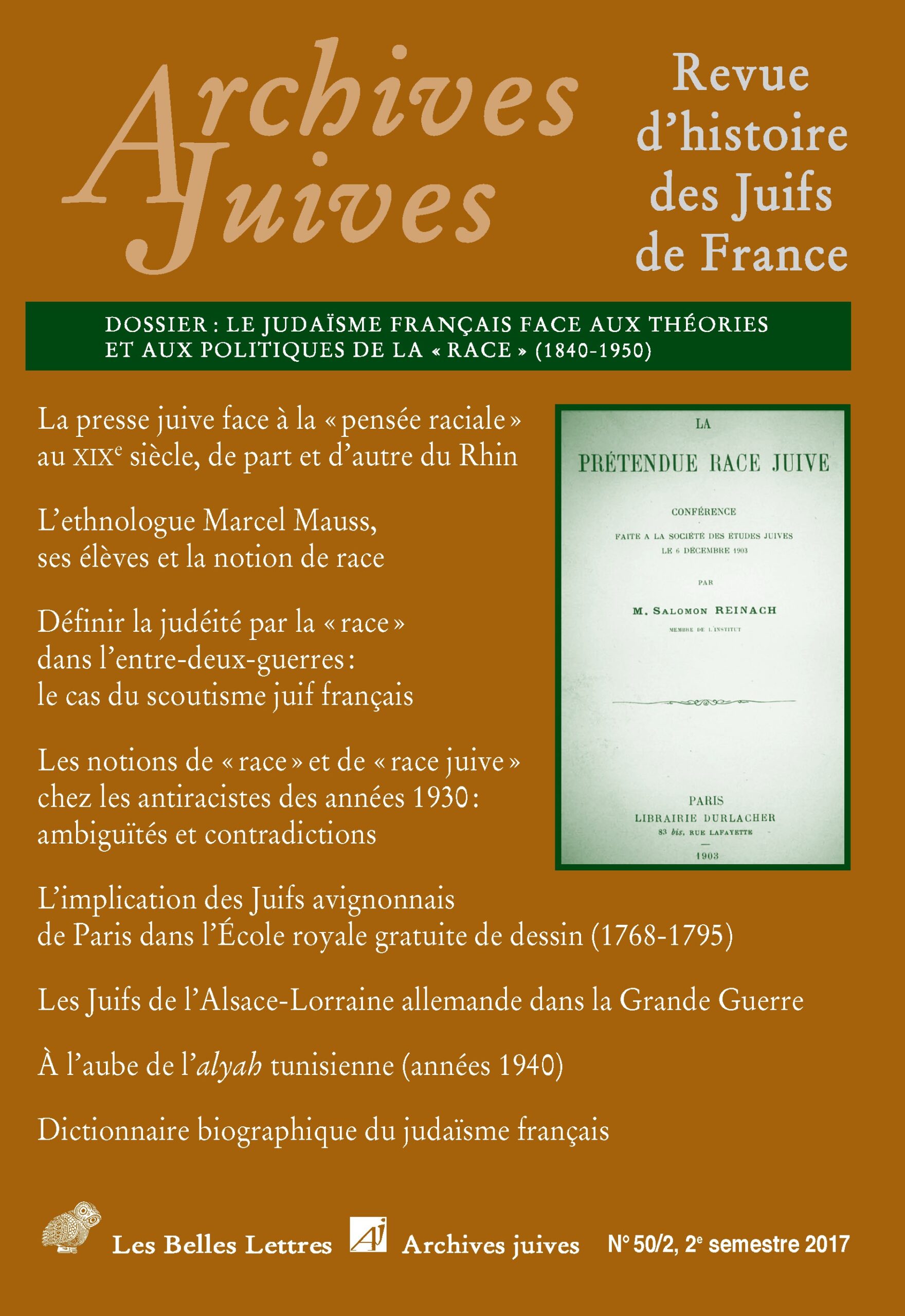
Découvrir
Éditorial
Que certains Juifs revendiquent hautement, aujourd’hui, et en toute connaissance de cause, leur appartenance à la « race juive », leur « sang » et leurs gènes juifs laisse sans voix. Ce dossier, conduit par Vincent Vilmain, nous ramène à un temps, le xixe siècle, où certes les « israélites » se disaient frères « de race », mais en toute innocence. Plus ils s’assimilaient, plus ils peinaient à nommer ce qui faisait l’essence du judaïsme. Une religion, comme le préconisait l’idéologie israélite ? Mais, de religion, ils n’en avaient plus guère. À défaut, Bernard-Lazare invoquait une mission révolutionnaire, héritée du prophétisme biblique ; les plus nombreux se rabattaient sur l’histoire, la culture juive en général, ou encore les valeurs à la fois juives et universelles reçues en partage. Une chose était sûre : pas question de recourir, comme les nationalistes juifs, à la notion de « peuple juif ». Dans ces conditions, le terme de « race » s’est souvent imposé comme une commodité pour désigner l’ensemble indéfinissable de ce qui faisait lien entre les Juifs, quand d’autres parmi leurs concitoyens parlaient de « race » bretonne ou berrichonne sans que cela porte à conséquences. Il était aussi beaucoup question de l’« âme » des peuples, pour la même raison. Avec l’émergence à la fin du siècle de la raciologie et de l’antisémitisme moderne dans la foulée de la science linguistique, ces approximations n’auraient plus dû être de mise. Mais ce dossier montre excellemment que, si les intellectuels juifs deviennent effectivement méfiants, la notion de « race juive » reste présente chez les intéressés dans l’entre-deux-guerres dans certains milieux sionisants, comme le scoutisme israélite, que les antiracistes eux-mêmes ne parviennent pas à s’en dégager totalement, tandis que les premiers anthropologues, dont la plupart pourtant, et les plus fameux, ne lui accordent aucun crédit, discernent mal encore son extrême dangerosité. La Seconde Guerre mondiale se chargea d’éclairer toutes les lanternes, définitivement pensait-on…
Mais, au-delà du contenu de ce numéro qui comporte par ailleurs d’autres rubriques habituelles, nous avons à cœur d’annoncer d’importants changements dans la vie de la revue. Tout d’abord, Archives juives sera éditée par les Presses universitaires de France à partir de 2018. Le moment m’a paru idéal, ensuite, pour mettre un terme à mes fonctions de rédactrice en chef et passer le témoin à la génération suivante. C’est sur les épaules de Valérie Assan et Heidi Knörzer, deux de mes proches collaboratrices, soutenues par un comité de rédaction fidèle au poste, que pèsera donc la responsabilité des numéros suivants. En 1963, Bernard Blumenkranz entreprenait de ronéotyper à son domicile un bulletin pour la toute nouvelle CFAJ. En 1994, la CFAJ remise en ordre de bataille par André Kaspi en faisait une véritable revue éditée chez Liana Levi. Succédant à Annette Wieviorka en 1997, j’ai conduit ses destinées pendant 20 années aux Belles Lettres, l’installant dans le paysage des revues savantes. Nous puisons dans nos acquis la conviction que le changement d’éditeur et de direction non seulement ne découragera pas la fidélité de nos lecteurs mais permettra d’en conquérir de nouveaux et de servir mieux encore l’histoire des Juifs de France et d’Afrique du Nord.
C.Nicault
Sommaire
Dossier : Le judaïsme français face aux théories et aux politiques de la « race » (1840-1950)
Les Juifs de France face à l’idée de « race » (1840-1940). Introduction par Vincent Vilmain
Les vives polémiques suscitées ces dernières années par les recherches en génétique des populations relativement à l’existence de spécificités juives – concernant leurs résultats ou tout simplement leur pertinence dans la conception d’une identité juive – invitent le chercheur à se replonger dans le xixe siècle, une époque où le judaïsme, en pleine redéfinition, se trouvait confronté à une notion de « race », alors triomphante. Si l’historiographie consacrée aux rapports des Juifs à l’idée de « race » est particulièrement fournie, elle concerne pour l’essentiel deux aspects : d’une part les Juifs comme victimes de l’antisémitisme et des politiques raciales, et, d’autre part, les Juifs comme acteurs des mouvements antiracistes, dénonçant par exemple les politiques de ségrégation aux États-Unis dans les années 1950 ou l’Apartheid en Afrique du sud. Jusqu’aux années 1990, rares étaient en revanche les travaux qui étudiaient les usages par les Juifs eux-mêmes de l’idée d’une « race juive »]. Or, au xixe siècle et au début du xxe siècle, la « race », conçue comme une évidence, est aussi définie et interprétée de façon très diverse. Elle est de toutes les manières incontournable à tel point que publicistes, médecins, scientifiques ou érudits juifs font un usage fréquent du terme, voire reprennent les méthodes de la raciologie, notamment l’anthropométrie.
Si de nombreuses études ont désormais vu le jour sur ce sujet, plus rares sont les publications concernant le judaïsme français. La France souffre en effet du diagnostic posé par John M. Efron, l’un des pionniers des études des conceptions raciales au sein du judaïsme, selon lequel les Juifs de France, relativement épargnés par l’antisémitisme racial, auraient eu moins de raison de prendre position sur cette notion de race que leurs coreligionnaires allemands. Outre que la première affirmation est en soi contestable, la corrélation l’est tout autant. Beaucoup de chercheurs ont notamment signalé que les Juifs britanniques, bien qu’épargnés par un antisémitisme virulent, ont été parmi les plus productifs en matière de raciologie. L’objectif de ce dossier est donc multiple, combler les lacunes historiographiques dans le domaine français, discuter l’affirmation de J. M. Efron selon laquelle la « race » aurait exercé un moindre attrait en France, remettre en question les frontières bien trop rigides entre les judaïcités d’Europe et questionner les dynamiques à l’œuvre en matière de transferts et d’hybridation de la pensée raciale….
/ Summary not yet available
1887. La réception de la « pensée raciale » dans l’Allgemeine Zeitung des Judenthums et les Archives israélites, par Heidi Knörzer
Voir résumé en anglais.
/ Attitudes toward racial thinking in the Allgemeine Zeitung des Judentums and the Archives Israélites
A certain number of comparative studies, which are the fruit of a schema opposing a more universalist-minded France with a more ethnically-minded and anti-Semitic Germany, contend that racial thinking was more prominent among German Jews than among their French coreligionists. An analysis of the reception of racial theories by the editors of the Archives israélites and the Allgemeine Zeitung des Judenthums nuances this thesis. As this article demonstrates, both editors participated in discussions around racial thinking that marked public debates in the nineteenth century, and their positions—at least until the emergence of modern anti-Semitism at the end of the 1870s—were similar.
Marcel Mauss et la notion de « race » face à la montée des fascismes, par Alice L. Conklin
Voir résumé en anglais.
/ Marcel Mauss and the idea of race faced with the rise of fascismin the nineteenth century
In a 1920 public lecture on nationality, Marcel Mauss noted that “in sum, it is because the nation creates the race that it is thought that the race creates the nation.” Despite this early sociological insight that race was always a social construction, Mauss did not challenge fellow ethnologist George Montandon directly when the latter began popularizing vicious new scientific forms of biological racism and anti-Semitism in interwar France. Mauss did, however, undermine the revival of scientific racism in other ways, particularly in his teaching and research. In works such as The Gift and in his many seminars, Mauss developed a generous and pluralist valuing of human difference that deeply influenced his students. Armed with Mauss’s insights, these students analyzed the devastating effects of escalating racism at home and in the empire more powerfully than their mentor did; several would go on to join the first global anti-racist campaign launched by UNESCO in the wake of the Holocaust. In short, Mauss’s response to the racist abuse of science unleashed by fascism was both layered and indirect. »
Race, corps et dégénérescence chez les Éclaireurs israélites dans l’Entre-deux-guerres, par Erin Corber – Article traduit de l’anglais par Vincent Vilmain
Voir résumé en anglais.
/ Race, the body, and degeneration in the Jewish scouting movement in the interwar years
The Éclaireurs israélites de France (EIF), founded in 1923, has been the subject of a number of scholarly studies focusing on the movement’s religious, moral, and/or political nature, its role as a node of Jewish resistance against persecution during the Holocaust, and its character as an incubator for Zionism before the establishment of the state of Israel. While these are all significant dimensions of the movement’s history, they obscure the degree to which Jewish young people also participated in broader French (and European) interwar projects of national racial reconstruction. This article reexamines the educational programing among EIF scout leaders, movement organizers, and young scouts to make them vitally concerned with defining and redesigning Jewishness by using the terms and categories of race. Natural and social sciences formed the unequivocal bases of scouting programs aimed at “building new Jews,” while religious and theological issues remained under heated debate until the outbreak of the Second World War. This study contributes to a larger argument that during the 1920s and 30s, physical health and wellness emerged as key imperatives of France’s transforming Jewish community, mirroring, building on, and sometimes resisting broader French interests in public hygiene, national demographic reconstruction, and various styles of eugenic racial thinking.
« S’il est vrai qu’il y ait des races… » Les notions de « race » et de « race juive » chez les militants antiracistes des années 1930, par Emmanuel Debono
Voir résumé en anglais.
/ “And if races really existed. . .” Notions of race and “the Jewish race” among militant antiracists in the 1930s
Founded at the end of the 1920s, the Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA) invented militant anti-racism in France. Denouncing anti-Jewish attacks in its first years of existence, activists from this organization rapidly affirmed their desire to combat all forms of racism. The 1930s, which are the chronological focus of this article, were also a decade in which racial thinking dominated: its influence weighed on ideas, discourses, and slogans forged by these activists as well as the representations of sympathizers who stood with them. Notions of race and more specifically a Jewish race thus occupied a central place in the activism of this organization. The usage of such notions—albeit intended to fight racism—nonetheless give rise to certain ambiguities and even contradictions.
Mélanges
Les Juifs avignonnais de Paris et l’École royale gratuite de dessin (1768-1795), par Jacques Gerstenkorn
Voir résumé en anglais.
/ The Avignonese Jews of Paris and the École royale gratuite de dessin (1768-1795)
Founded in 1766 by the painter Jean-Jacques Bachelier, the l’École royale gratuite de dessin of Paris, better known as the École nationale supérieure des arts décoratifs, appealed to private patrons at the time of its establishment. It so happens that in 1768, among the very first patrons (who became known as founders) were twenty-seven Jews who traced their origins to Avignon and worked as haberdashers. Several months earlier, six of them had benefited from a royal edict of March 1767, which gave them the right to buy their patents. The collective participation of Avignonese Jewish families in Bachelier’s project thus appears to be part of a strategy of consolidating newly acquired and cherished rights, while at the same time getting in the good graces of the lieutenant general of the Paris Police. This phenomenon reveals the Avignonese Jews’ desire to integrate into French society, while also indicating their still very marked belonging to a group that not only shared the same geographical and confessional origins, but also had a common professional identity and practiced inmarriage.
Du sacrifice à l’oubli : les soldats juifs de l’Alsace et de la Moselle allemandes (1914-1918), par Philippe Landau
Voir résumé en anglais.
/ From sacrifice to obscurity: Jewish soldiers from German Alsace and Moselle (1914-1918)
After the allied victory, the attitudes of the Reichsland Jews from Alsace-Lorraine during World War I were an unsettling chapter for French Jews as much as for their coreligionists in Alsace and Moselle, who had, yet again, become French. After the conflict, French Jews claimed Reichsland Jews had remained loyal to France. The reality is more complex, since forty years of Germanization could not be erased without a trace, especially among the youth. Furthermore, pro-German sentiments were stoked by the French alliance with pogrom-ridden Russia and the liberating role of the Reich for the Eastern European Jewish masses. At the same time, the memory of French emancipation and anti-Semitism dominant in the Reich’s army pulled opinions in the other direction. This article will attempt to analyze the attitudes and behavior of Jews from Alsace and Moselle who were mobilized from 1914-1918.
L’émigration des Juifs de Tunisie en Palestine dans les années 1940. L’impact de l’idéal sioniste, par Olfa Ben Achour
Voir résumé en anglais.
/ The emigration of Tunisian Jews to Palestine in the 1940s. The impact of the Zionist ideal
From 1943 to 1948-49, at least 4,000 Tunisian Jews left North Africa for Palestine and then the State of Israel, just like tens of thousands of European Jewish survivors after the war. Situated in the particular conditions of colonial North Africa, these departures, usually illegal and clandestine, were the fruit of Zionist propaganda that had been disseminated for decades among the Jewish youth of Tunisia, the effects of which were amplified under Vichy and the German occupation. Utilizing sources from the Tunisian protectorate, this article will focus on the ideological factors behind departures, but will also shed new light on how departures were organized (often by Algerian Zionists, of which there were not many) and the ambivalent attitude of the French authorities.
Dictionnaire
Justin Dennery, général de brigade (Metz, 24 décembre 1847 – Neuilly-sur-Seine, 26 octobre 1928), par Philippe Landau
Lectures
Jacques Canet et Claude Nataf (dir.), La Synagogue de la Victoire. 150 ans du judaïsme français, Paris, Éditions Porte-Plume, 2017

