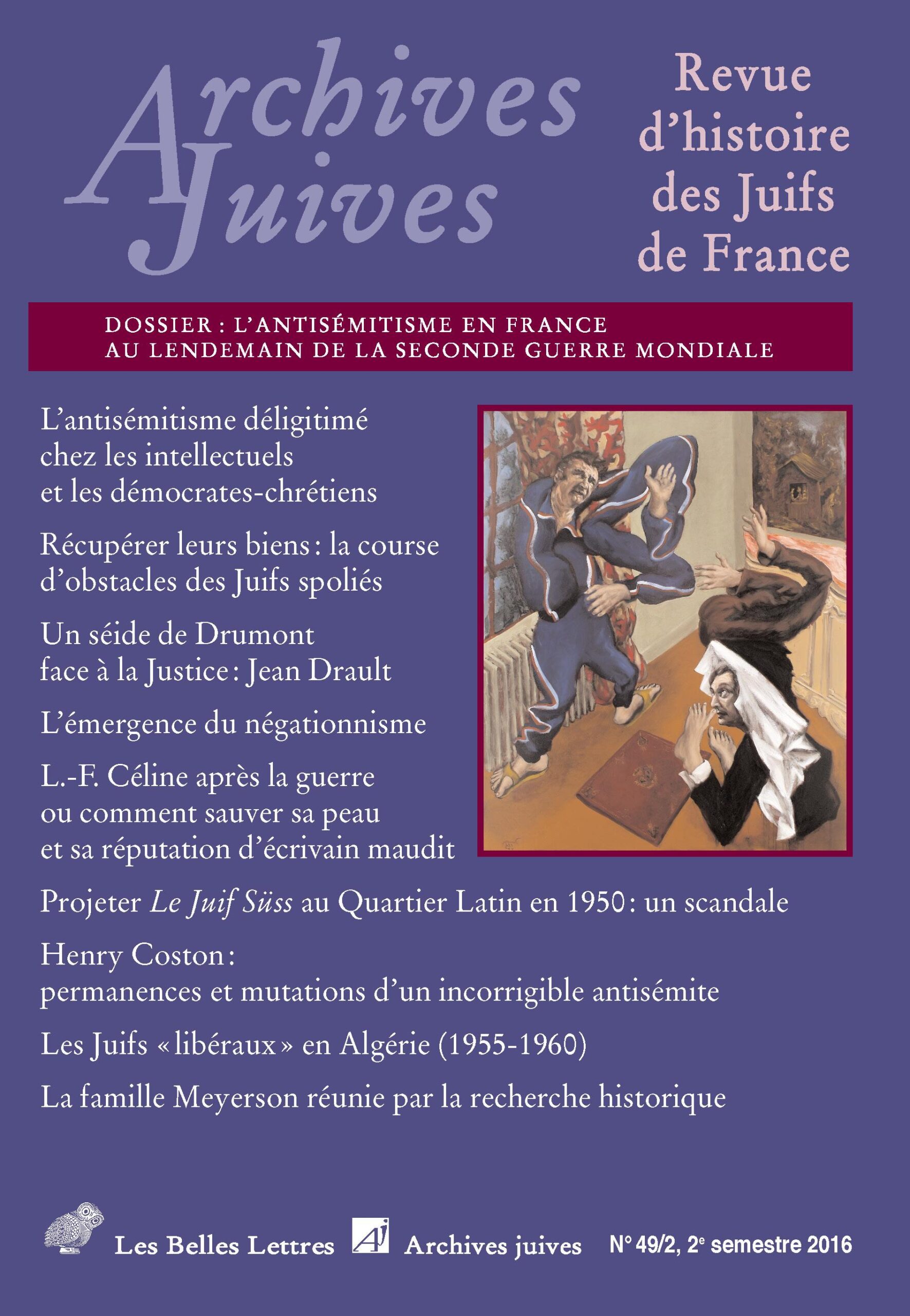
Découvrir
Éditorial
Si l’antisémitisme est un thème rarement absent de nos numéros, ce dossier est le troisième seulement que nous lui consacrons à part entière, si l’on inclut le tout premier, en 1994, sur l’affaire Dreyfus. Emmanuel Debono, l’un de nos meilleurs spécialistes en la matière, dirige ici une enquête sur les destinées de l’antisémitisme dans la France de l’après-Seconde Guerre mondiale. Curieusement, les historiens ont tardé à se pencher sérieusement sur cette période. Plus exactement, tentés comme souvent par l’analyse du discours extrémiste plus que par celle de « l’antisémitisme ordinaire », poussés aussi par l’actualité – l’émergence notamment d’un certain professeur Faurisson sur le devant de la scène à la fin des années 1970 –, c’est vers la généalogie du négationnisme qu’ils dirigent leurs premiers travaux. Aussi pertinents soient-ils, un article d’Anne Grynberg mis à part, ils laissent de côté cette question : hormis quelques irréductibles fanatiques, la France de l’après-guerre et de l’après-Shoah s’est-elle vraiment réveillée miraculeusement guérie des virulences de l’avant-guerre et lavée de la propagande antijuive de Vichy et de l’occupant ?
Naturellement, il n’en est rien. Les préjugés, on le sait, ont la vie dure, d’autant qu’en l’espèce, ils viennent parfois au secours des intérêts menacés des profiteurs de biens juifs. Ce dossier le confirme après les travaux de Pierre Birnbaum, par exemple, sur Pierre Mendès France qui continua d’en payer le prix après-guerre, ou de Michel Leymarie sur les frères Tharaud, écrivains qui n’ont de cesse alors de renouer avec une veine antisémite à laquelle ils avaient préféré renoncer pendant l’Occupation. Les témoignages personnels se font aussi plus nombreux depuis quelques années. Après le peintre Gérard Garouste que nous tenons ici à remercier pour nous avoir autorisé à reproduire en couverture un tableau inspiré par son géniteur antisémite et spoliateur, Pascal Bruckner a révélé à son tour dans Un bon fils (Grasset, 2014) avoir grandi auprès d’un père et d’une mère du même acabit. Ce qui, au passage, montre bien que l’antisémitisme ne s’hérite pas forcément…
Néanmoins, ce constat d’une certaine permanence de l’antisémitisme et de l’apparition d’un antisémitisme « relooké » sous les traits du négationnisme et de l’antisionisme ne doivent pas occulter le fait qu’après la guerre, l’antisémitisme a perdu toute légitimité morale, philosophique et religieuse pour le gros des élites et bien au-delà. C’est là un fait capital qui, quoiqu’on en dise aujourd’hui parfois, reste toujours globalement vrai.
Bref, en mettant en évidence cette complexité, en la rendant plus intelligible, ce dossier dégage les lignes de force que suivront les recherches futures sur une problématique qui, à l’évidence, est loin d’être épuisée. Du fait de l’ampleur du dossier, nous ne proposons aux lecteurs qu’un seul Mélange, mais consistant et traitant d’un sujet sensible : les Juifs « libéraux » dans l’Algérie en guerre. Outre les « Lectures », nous avons fait place aussi, pour une fois, à un petit texte très personnel d’Eva Telkès-Klein narrant comment ses recherches ont réuni, par-delà la Shoah, les deux branches d’une famille juive franco-polonaise qui s’ignoraient.
C.Nicault
Sommaire
Dossier : L’antisémitisme en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
Introduction par Emmanuel Debono
Les pics d’antisémitisme qu’a connus la France sont bien documentés par la recherche historique, qu’il s’agisse, pour la période contemporaine, du « moment antisémite [1] » de l’affaire Dreyfus ou des années 1930. La persécution d’État qui s’ensuit entre 1940 et 1944, et, plus généralement, le sort des populations juives dans l’Europe en guerre se présente comme un aboutissement paroxystique des discours et des actes de haine de la période précédente. En 1945, la découverte des camps de concentration et des centres de mise à mort nazis produit un choc qui a des effets de délégitimation de l’opinion antijuive. Mais les contours de cette délégitimation sont complexes puisqu’ils ne se traduisent ni par sa réduction au silence, ni par sa disqualification totale. Ce qui disparaît avec la libération de la France, c’est le vacarme des diatribes antijuives de la presse collaborationniste, l’affichage public de la haine raciale par une exposition telle que Le Juif et la France (Paris, 1941), la propagande cinématographique ou encore les émissions de Radio-Paris. Ce qui est devenu informulable, ce sont les appels à l’exclusion et à l’élimination des Juifs de la société, politique dont on mesure désormais l’étendue et les funestes effets. Ce qui est devenu invisible, c’est l’inscription dans le paysage français, dans sa politique, ses institutions et ses lois, de la persécution raciale à laquelle durent faire face, au quotidien, les Juifs de France, français et étrangers…
/ Summary not yet available
La délégitimation de l’antisémitisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par François Azouvi
L’antisémitisme n’a pas disparu en France avec la guerre et les persécutions: il lui faudra très peu de temps pour réapparaître. Mais il a perdu sa légitimité, et ce sur un triple plan : moral, philosophique, religieux. Moral, et c’est en ce sens que, comme le dira Bernanos, Hitler a « déshonoré » l’antisémitisme. Philosophique, et il revient à Sartre d’en avoir administré la preuve en montrant qu’il n’y a pas de « question juive » mais une « question antisémite ». Religieux, grâce à la prise de conscience des chrétiens du rôle de l’antijudaïsme d’Église dans la survenue de l’antisémitisme nazi. Déligitimé, l’antisémitisme ne perd pas sa force mais sa langue. Il lui faudra une vingtaine d’années pour en trouver une nouvelle, sous la forme de l’antisionisme.
/ Delegitimizing Anti-Semitism in the Immediate Post-World War II Period
Anti-Semitism did not disappear in France with the war and persecutions: it did not take long for it to reappear. However, it did lose its legitimacy in the moral, philosophical and religious domains. In the moral domain, as Bernanos said, Hitler “dishonored” anti-Semitism. In the philosophical domain, it fell upon Sartre to demonstrate the proof, showing that there is no “Jewish question” but an “anti-Semitic question.” In the religious domain, thanks to the realization among Christians of the role of the Church’s anti-Judaism in the development of Nazi anti-Semitism. Being delegitimized, anti-Semitism did not lose its strength, but it did lose its voice. It took about twenty years to find a new one, in the form of anti-Zionism.
La solitude des Juifs spoliés confrontés au problème de la récupération de leurs biens après l’Occupation, par Florent Le Bot
Les témoignages convergent soulignant les difficultés pour les Juifs à retrouver leur place dans la société française de l’après-guerre. La formule de Jean-Jacques Bernard clamant avec amertume au moment de sa libération du camp de Compiègne : « Et pourtant, il ne faudra pas présenter sa créance ! » en dit long à ce propos. Les associations de défense d’administrateurs provisoires ou de spoliateurs de biens juifs déroulent un ensemble d’arguments puisés dans le vieux fond de l’antisémitisme pour tenter de défendre l’indéfendable. Les archives du résistant Lucien Rachline exhumées par son fils ou le témoignage de Gérard Garouste à propos de son père spoliateur complètent le tableau. Mais finalement c’est le rôle des institutions (Caisses des dépôts et consignations, etc.) qui paraît le plus affligeant.
/ The Terrible Solitude of Pillaged Jews who Attempted to Recover Their Property after the Occupation
All existing testimony emphasizes the difficulty that Jews had in reintegrating into post-war French society. Jean-Jacques Bernard’s bitter cry at the moment of his liberation from the Compiègne concentration camp—‘‘We were expected not to speak of our sufferings’’—speaks volumes of this phenomenon. The defense organizations of temporary administrators and spoliators of Jewish property reveal a collection of arguments that rest on a well-established undercurrent of anti-Semitism in order to defend the indefensible. The archives of resistance member Lucien Rachline, uncovered by his son, or the testimony of Gérard Garouste regarding his father who participated in the spoliation of Jewish property, completes the picture. But in the end, it was the role of institutions (Caisse des dépôts et consignations, etc.) that appears to be the most damning.
L’antisémitisme en procès : Jean Drault devant ses juges (4 novembre 1946), par Grégoire Kauffmann
Le 4 novembre 1946 s’ouvre à Paris le procès d’Alfred Gendrot dit Jean Drault (1866-1951), doyen de l’antisémitisme français. Ancien pilier de La Libre Parole, le quotidien fondé en 1892 par Édouard Drumont, le vieux militant et journaliste antijuif s’était engagé avec enthousiasme dans les rangs du collaborationnisme après la défaite de 1940. Successivement directeur du journal pro-allemand La France au travail et de l’hebdomadaire de chantage Au Pilori, membre influent de l’Institut d’études des questions juives, Jean Drault fait alors le trait d’union entre l’époque de l’affaire Dreyfus et l’antisémitisme des années noires. En cet automne 1946, à l’heure où la France s’apprête à élire l’Assemblée législative de la IVe République, quelle signification donner au procès Jean Drault, abondamment relayé dans la presse ? Cet épisode judiciaire oublié jette un éclairage inédit sur l’héritage idéologique d’Édouard Drumont et la perception de l’antisémitisme par l’opinion publique dans l’immédiat après-guerre.
/ Anti-Semitism on Trial: Jean Drault in Front of His Judges (November 4, 1946)
On November 14, 1946, the trial of Alfred Gendrot alias Jean Drault (1866-1951), an ‘‘elder’’ of French anti-Semitism, began in Paris. A former pillar of La Libre Parole, the paper founded in 1892 by Édouard Drumont, the old activist and anti-Jewish journalist had enthusiastically joined the ranks of the collaborationists after the defeat of 1940. Successively director of the pro-German paper La France au travail and Au Pilori, a weekly paper whose purpose was to denounce Jews and thus expose them to persecution, also an influential member of the Institut d’études des questions juives, Jean Drault’s anti-Semitism bridged the Dreyfus era and the dark years of the 1930s. In the autumn of 1946, just as France was preparing to elect a legislative assembly for the Fourth Republic, what significance should we give to the trial of Jean Drault, which drew substantial media attention at that time? This now forgotten judicial episode casts new light on the ideological heritage of Édouard Drumont and the French public’s perception in the immediate post-War years.
Les premières voix françaises du négationnisme (1945-1953), par Valérie Igounet
Dans un contexte d’après-guerre traumatisé par le génocide des Juifs, les antisémites éprouvent bien des difficultés à se faire entendre. Il s’agit, pour eux, de trouver une nouvelle formulation, incluant la haine des Juifs et de nouveaux marqueurs. Le négationnisme apparaît trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il réinvestit les fondamentaux du discours antisémite classique et prend en compte, immédiatement, la création de l’État d’Israël laissant apparaître un de ses buts : nier les fondements historiques de l’État hébreu. 1945-1953 : les premières voix du négationnisme trouvent leurs représentants aux deux extrémités de l’échiquier politique. Entre un fasciste revendiqué et un ancien déporté, le second s’impose comme le fondateur d’un discours qui puiserait soi-disant ses racines non pas dans la politique mais dans la recherche de la vérité historique.
/ The First French Holocaust Deniers (1945-1953)
In the context of a post-War France traumatized by the Jewish genocide, it was difficult for anti-Semites to make themselves heard. They thus had to reframe their arguments, in order to integrate hatred of Jews into new discourses. Holocaust denial reared its ugly head three years after the end of World War II. It reframed the fundamentals of classic anti-Semitic discourse while taking into account the creation of the state of Israel, thus revealing one of its objectives: to deny the historical legitimacy of the newly created Jewish state. Between 1945 and 1953, the first voices of Holocaust denial sprang from opposite sides of the political spectrum. On one side we find a self-proclaimed fascist, and on the other a concentration camp survivor, the second becoming the founder of a discourse that would ground itself not in politics, but in the search for historical truth.
Céline, fabrication d’une légende victimaire et découverte du négationnisme (1944-1951), par Pierre-André Taguieff
De sa fuite en Allemagne (17 juin 1944) à son amnistie (20 avril 1951), due à un tour de passe-passe juridique, Céline s’est employé fiévreusement à fabriquer sa légende victimaire avant de découvrir avec un intérêt passionné, à l’automne 1950, le négationnisme à l’état naissant. Les trois principales composantes de sa légende – l’innocent persécuté, le patriote pacifiste et l’écrivain maudit, la victime expiatoire – vont jouer un rôle majeur dans la réhabilitation de l’écrivain-pamphlétaire, engagé dans la propagande antijuive fin 1937 puis dans la Collaboration. Elles ont orienté jusqu’à ces dernières années les écrits journalistiques et académiques sur Céline, et façonné l’opinion du grand public sur le « génie littéraire ». Il est le premier écrivain reconnu à mettre en musique le doute sur l’extermination nazie des Juifs d’Europe. Le « puissant visionnaire antijuif », selon la formule de Jean Drault, a aussitôt perçu qu’il y avait là une arme symbolique susceptible de relancer la haine des Juifs sur de nouvelles bases.
/ Céline, the Construction of a Legend of Victimhood and the Discovery of Holocaust Denial (1944-51)
From his escape to Germany (June 17, 1944) until his amnesty (April 20, 1951), a result of judicial trickery, Céline worked overtime to construct his legend of victimhood, before discovering, in autumn 1950, a passionate interest in Holocaust denial in its early phases. Three major elements of his legend—the persecuted innocent, the pacifistic patriot, and the cursed writer—would play a major role in the rehabilitation of the writer-pamphleteer, who engaged in anti-Jewish propaganda from late 1937 through the Collaboration. These elements have oriented even recent journalistic and academic writing on Céline, shaping public opinion on his “literary genius.” He was the first recognized writer to cast doubt upon the Nazi extermination of European Jews. This “powerful anti-Jewish visionary,” to use the expression of Jean Drault, quickly perceived in Holocaust denial a symbolic weapon, capable of reigniting the hatred of Jews for new reasons.
Le Juif Süss au Quartier Latin en 1950. Entre emballement médiatique et réalité de l’antisémitisme, par Emmanuel Debono
En octobre 1950, la programmation du film de propagande nazie Le Juif Süss, par un ciné-club dirigé par Éric Rohmer, dans une salle du Quartier Latin (Paris), déclenche un véritable tollé. Démarche réflexive menée par des passionnés du Septième Art ? Provocation d’un groupuscule antisémite ? Simple coup médiatique ? Militants antiracistes et associations de résistants n’ont pour leur part aucun doute : ils exigent immédiatement l’interdiction de la projection et une plus grande vigilance des pouvoirs publics face au « retour du fascisme ». Le scandale du Juif Süss révèle le caractère plausible d’une manifestation antisémite en ce début des années 1950, en France, ainsi que les réactions nourries de la société civile et des institutions. Il est l’occasion d’interroger la place des discours de haine dans la période post-Shoah ainsi que les moyens d’action pour les combattre.
/ The Juif Süss in the Latin Quarter in 1950. Between Media Uproar and Anti-Semitic Reality
In October 1950, a cinema club directed by Éric Rohmer created an uproar by screening the Nazi propaganda film, Le Juif Süss, in a cinema in the Latin Quarter (Paris). Was this a reflexive approach, led by a group of cinephiles? A provocation of a small anti-Semitic group? A simple publicity stunt? Anti-racist activists and resistant associations were in no doubt, and immediately demanded the cancellation of the screening and greater awareness on the part of public officials about the “return of fascism.” The scandal of the Juif Süss reveals the plausible nature of anti-Semitism in the early 1950s, as well as the reactions of civil society and institutions. It creates the opportunity to question the place of hate speech in the post-Shoah period, as well as the means used for combatting it.
Permanences et mutations de l’antisémitisme costonien, par Olivier Dard
Henry Coston (1910-2001) compte parmi les plumes les plus connues de l’histoire de l’antisémitisme français du XXe siècle. Centré sur la seconde partie de son itinéraire, des années 1950 jusqu’à sa mort, cet article présente le dispositif éditorial mis en place par l’ancien patron de La Libre Parole et les adaptations de son antisémitisme, rendues nécessaires par l’évolution du contexte. Professionnel de l’imprimé, Coston fut à la fois un directeur de revue (Lectures françaises) et un libraire-éditeur (La librairie française). Il fut aussi l’auteur de dizaines de brochures et ouvrages analysés ici à travers les références mobilisées, les méthodes employées, les discours antisémites développés et enfin leur impact en France et à l’étranger (Europe/Amériques).
/ Continuity and Change in the Anti-Semitism of Henry Coston
Henry Coston (1910-2001) is among the most well-known of anti-Semitic writers in the history of twentieth century French anti-Semitism. Centered on the second part of his career (from the 1950s until his death) this article is a presentation of the editorial policies put into place by Coston as editor of La Libre Parole, and looks at the ways in which he adapted his anti-Semitism where necessary, in accordance with changing circumstances. Coston was both a magazine editor (Lectures françaises) and a book editor (La librairie française). He was also the author of dozens of brochures and books, analyzed here through the references and methodologies that he used, the anti-Semitic discourses that he developed and, finally, the impact of his writing in France and abroad (Europe and the Americas).
Mélanges
« À moins de nier notre qualité de Juifs… ». Les Juifs d’Algérie dans le mouvement « libéral » de la guerre d’indépendance (1955-1960), par Pierre-Jean Le Foll-Luciani
Pendant la guerre d’indépendance algérienne, les “mouvements libéraux”, rares parmi les Français d’Algérie, s’opposaient à la répression, mais aussi aux « ultras » (pro-Français) de l’Algérie française. Les libéraux demandaient une trêve et des négociations pour en finir avec le régime colonial. Numériquement surreprésentés dans plusieurs de ces groupements libéraux, des Juifs d’Algérie ont affirmé être à l’époque des « Juifs libéraux » qui défendaient des opinions politiques propres au judaïsme algérien. Cet article examine les fondements, les modalités et la portée de ces engagements, et s’intéresse en particulier à la désignation identitaire – par soi et/ou par les autres – et l’usage du référent à la mobilisation du référent « juif » comme référent politique.
/ “Unless We Deny the Fact We Are Jews….” Algerian Jews in the “Liberal Movement” during the War of Independence (1955-1960)
During the Algerian War of Independence, “liberal movements,” rare among the French in Algeria, opposed repression, but also the “ultras” (pro-French) of French Algeria. Liberals demanded a truce and negotiations as a means of ending the colonial regime. Numerically over-represented in several of these liberal movements, Algerian Jews organized at times as “Liberal Jews,” claiming to hold political opinions specific to Algerian Jewry. This article questions the basis, modes and extent of such mobilizations, and focuses in particular on identity markers—by one’s self or by others— and the usage of the “Jewish” reference as a political reference.
Histoire et égohistoire
Entre France et Pologne, les retrouvailles de la famille Meyerson ou les surprises de la recherche historique, par Eva Telkes-Klein
Lectures
Philippe Landau, Les Soldats juifs dans la Grande Guerre. 1914-1918. Le Livre du souvenir du Judaïsme français, Avant-propos de Joël Mergui, Préface de Pierre Birnbaum, Paris, CLKH / Les Éditions du Consistoire, 2015

