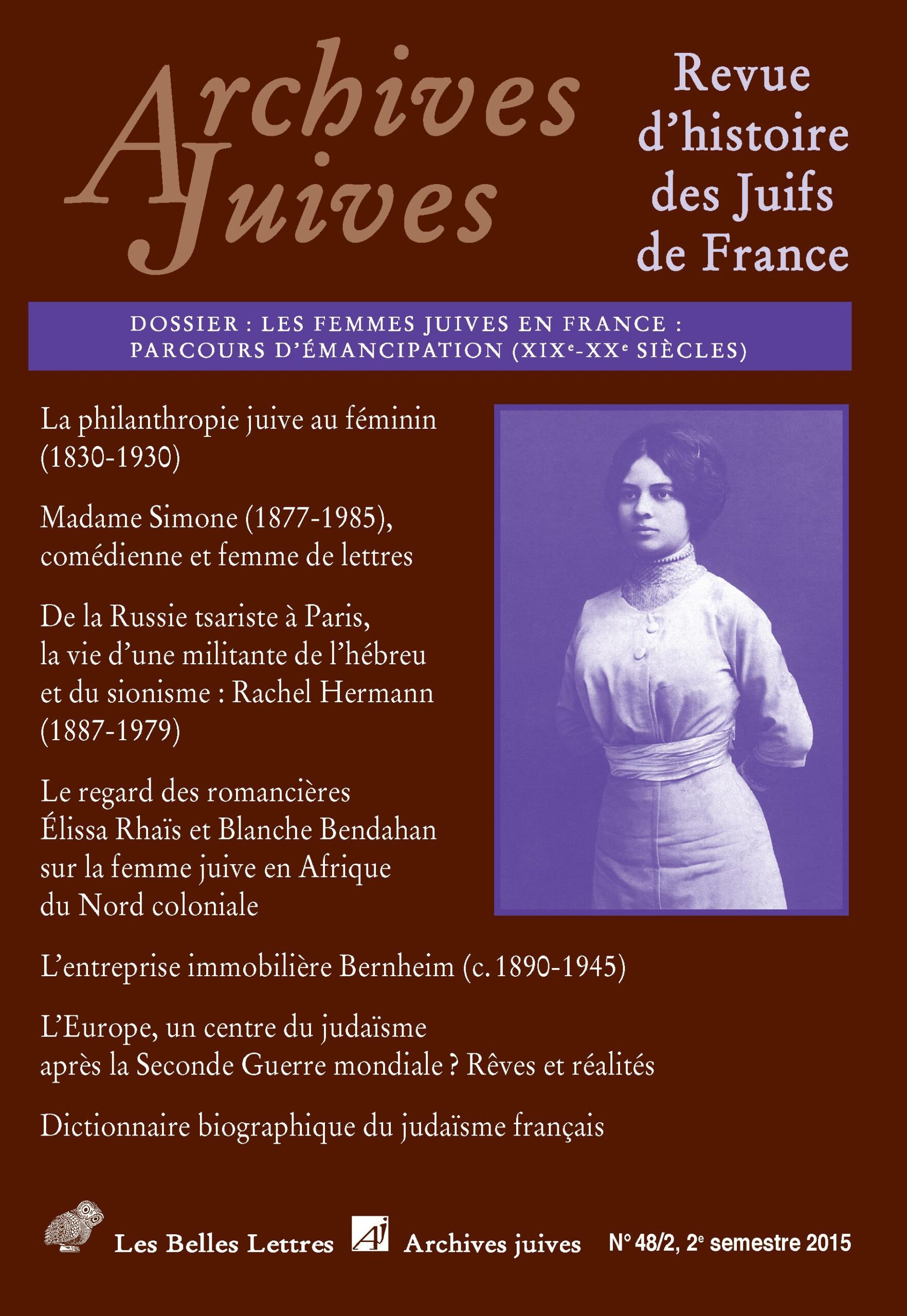
Découvrir
Éditorial
Depuis quand notre comité éditorial caresse-t-il le projet d’un dossier sur les femmes juives en France ? Bien avant en tout cas 2014 et la parution des 110 femmes juives qui ont marqué la France. XIXe et XXe siècles, de la sociologue Michèle Bitton. Depuis les années 1970, l’histoire des femmes en général et celle du genre se sont ménagées une place dans le paysage académique français, même si elles n’y rencontrent pas le même engouement qu’ailleurs, notamment aux États-Unis. Pourtant, nous ne parvenions pas à traduire notre projet en acte, faute, semblait-il, d’un bassin suffisant de chercheurs spécialisés.
À quoi attribuer l’« invisibilité » des femmes juives en France comme sujets d’histoire ? Outre le retard des recherches françaises sur l’histoire des femmes en général, on peut bien sûr incriminer le faible nombre des historiens spécialistes du fait juif dans notre pays, sans compter le « silence » bien connu des sources sur les femmes, qu’elles soient juives ou non. Mais comment expliquer alors qu’aucun chercheur étranger, aux États-Unis notamment, pays phare des études – éventuellement croisées – sur le judaïsme, les femmes et le genre, ne se soit emparé du sujet ? Après tout, les études sur le judaïsme américain au féminin ne manquent pas. Sans doute faut-il invoquer un facteur plus essentiel. L’histoire des Juifs dans la France moderne est fondamentalement celle d’une « nation » méprisée et volontiers persécutée, avant de devenir au XIXe siècle, avec l’Émancipation, celle d’une acculturation et d’une intégration sociale qui reste fragile, discutée, compromise à certains moments par des poussées récurrentes d’antisémitisme culminant dans le drame de la Shoah. Aussi la focale de la réflexion historique s’est-elle centrée sur la condition et sur l’identité juive en général dans ces environnements successifs, ainsi que sur les combats menés par les élites communautaires des XIXe et XXe siècles pour réaliser, malgré tout, un idéal d’« assimilation » non exclusif du particularisme. Et l’on a négligé, en ce qui concerne au moins l’époque contemporaine, l’histoire intime des Juifs de France, l’examen des rapports entre les sexes dans la cellule familiale, et partant, celui de la condition féminine. Si certaines « israélites » ont une certaine visibilité dans l’historiographie, c’est le plus souvent en raison de la contribution qu’en tant qu’épouses ou veuves de notables, elles ont apporté à leurs maris dans leur rôle d’illustrations et de guides pour leurs coreligionnaires.
Presque tout reste donc à faire pour que l’histoire des Juifs en France ne soit plus, peu ou prou, une « histoire sans les femmes ». Pour l’heure, nous nous bornons à pointer ici, à travers les portraits fouillés de quelques-unes d’entre elles vivant un siècle et plus après l’Émancipation, les voies qu’elles ont empruntées vers une émancipation personnelle, avec cette question à la clé : en quoi les obstacles rencontrés relèvent-ils de leur condition de Juives ? Familier du militantisme sioniste féminin et des « gender studies », Vincent Vilmain a bien voulu assurer la présentation du dossier. Qu’il en soit chaleureusement remercié. La place nous manque pour présenter les autres rubriques de ce numéro, pourtant élaborées avec le soin habituel, avec l’espoir que le lecteur aura plaisir à y satisfaire d’autres curiosités.
C.Nicault
Sommaire
Dossier : Les femmes juives en France : parcours d’émancipation (XIXe-XXe siècles )
Les femmes juives françaises face à l’émancipation, par Vincent Vilmain
Voilà maintenant plus de trente ans qu’ont paru les premières monographies de Marion Kaplan ou de Paula Hyman s’efforçant de relire le long siècle de l’émancipation des Juifs d’Europe sous un angle féminin. Cependant, à ce jour, le sujet n’a pas été traité dans le contexte français, malgré ses nombreuses spécificités. Pourtant les conséquences de l’émancipation y ont été rapides et impressionnantes, et l’embourgeoisement de la population juive précoce. L’attrait de l’assimilation pour une majorité de Juifs français s’y est exercé de façon profonde. Par conséquent, à l’image du reste de l’Europe occidentale et d’une partie de l’Europe centrale, assiste-on à un renversement des rôles traditionnels entre hommes et femmes et à un transfert, partiel, des responsabilités concernant le maintien d’une atmosphère religieuse et/ou culturelle spécifique au sein de la famille.
En effet, l’ethos bourgeois, auquel adhère progressivement une majorité de Juifs français, considère la religiosité comme féminine. Cependant, ce critère convient bien mieux au christianisme qu’au judaïsme où la religion est essentiellement une affaire d’hommes. Ainsi, les femmes sont-elles exemptées d’un certain nombre de mitzvot – les périodiques la plupart du temps, mais également l’étude de la Torah – et leur rôle traditionnel consiste surtout à mettre leurs maris dans les conditions de pouvoir respecter les commandements. Or, au xixe siècle, la réforme du judaïsme qui accompagne l’émancipation – phénomène bien moins influent en France qu’en Allemagne notamment – ne transfère pas les clefs de la religion juive aux femmes, loin de là. Non seulement elles ne « pénètrent » pas davantage la synagogue, mais elles ne reçoivent toujours qu’une éducation religieuse très superficielle, d’autant que s’impose progressivement l’idée d’une judéité essentialisée, sensée s’infuser spontanément dans les esprits juifs. Par conséquent, si l’on peut trouver valorisant que la femme juive soit, davantage que par le passé, la dépositaire de l’identité juive, celle-ci ne dispose pas de tous les outils nécessaires à son œuvre et cette responsabilité se révèle être à double tranchant…
/ Summary not yet available
Donner au féminin : Juives philanthropes en France (1830-1930), par Céline Leglaive-Perani
Cet article se propose d’étudier les motivations des femmes juives philanthropes en France au XIXe et au début du XXe siècles. Celles-ci relèvent d’abord d’une stratégie de sociabilité : en imitant les mœurs traditionnelles des femmes de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie, les femmes juives aspirent à développer leurs réseaux de sociabilité et à s’intégrer aux couches supérieures de la société. Mais elles pratiquent également la philanthropie pour des raisons qui tiennent à leur identité de Juives et à leur place dans la société majoritaire : en donnant à l’ensemble des Francais sans distinction de confession, elles affirment leur qualité de patriotes attentives au sort de leurs concitoyens. À l’image de leurs coreligionnaires masculins, elles conçoivent aussi leur générosité comme une forme de reconnaissance envers la France qui les a émancipées.
/ Giving as Women: Jewish Women Philanthropists in France (1830-1930)
This article studies the motivations of Jewish women philanthropists in France during the nineteenth and early twentieth centuries. Such motivations reveal a socialization strategy: by imitating the traditional mores of women from the aristocracy and the haute bourgeoisie, Jewish women sought to develop their social networks and integrate into higher socio-economic circles. Jewish women also participated in philanthropy for reasons that are associated with their identities as Jews and as members of the larger society: by giving to the French without distinction of religion, they affirmed their position as patriots who were concerned about the well-being of their fellow citizens. Like their male counterparts, Jewish women perceived their generosity as a form of recognition for France, their emancipator.
Madame Simone, une longue vie entre théâtre et littérature, par Chantal Meyer-Plantureux
Madame Simone est l’une des actrices vedette du boulevard durant la première moitié du XXe siècle. Son nom est associé au succès des pièces de Bernstein et elle devient bientôt le prototype de l’actrice « juive » : « cérébralité », « nervosité », « hystérie », tous les qualificatifs qui, depuis Drumont et sa France juive, courent sur les Juifs lui seront accolés durant toute sa carrière malgré la réelle admiration que lui manifestent le public et la critique. Mais la carrière théâtrale qu’elle a embrassée presque par hasard en épousant le grand comédien Charles le Bargy, ne lui apporta jamais une véritable satisfaction et c’est l’écriture qui fut sa véritable passion : durant presque cinquante ans – elle s’éteint à 108 ans – elle se consacra à la littérature : membre du jury du prix Femina, elle publiera nombre de romans et de textes autobiographiques.
/ Madame Simone, a Long Life in Theater and Literature
Madame Simone is one of the star actresses of the “boulevard” during the first half of the twentieth century. Her name is associated with the success of Bernstein’s plays, and she soon became the prototype of the “Jewish” actress: “cerebral,” “nervousness,” “hysteria,” all of the labels that were applied to Jews since Drumont and his France juive would become associated with her, in spite of the real admiration she inspired among the public and critics. Yet the theatrical career she embraced, almost by chance through her marriage to the great actor Charles Le Bargy, never gave her a real sense of satisfaction. Writing was her true passion. For almost fifty years—she passed away at 108—she consecrated herself to literature. Member of the jury of the prix Femina, she published numerous novels and autobiographical texts.
De la Russie à Paris : autobiographie d’une immigrée et d’une sioniste, Rachel Hermann (1887-1979), Extraits présentés par Nicole Samuel-Guinard, montés et annotés par Catherine Nicault
Née en Ukraine, vivant à Paris depuis 1917, Rachel Hermann rédigea sur le tard des mémoires en yiddish, restés jusqu’ici dans les archives de sa famille. Cet article présente des passages de la traduction réalisée par Henry Bulawko, accompagnés d’un important appareil critique. Avide de savoir, ayant côtoyé le milieu des intellectuels juifs d’Odessa, hébraïsante fervente, cette sioniste subsiste en donnant des leçons particulières d’hébreu en Palestine en 1914-1915, puis au Caire et enfin à Paris où elle épouse Nahum Hermann, un sioniste actif. À ses côtés, elle prend part aux grands événements de la vie sioniste et juive du Paris de l’entre-deux-guerres, travaille bénévolement pour l’Union hébraïque mondiale et voyage, notamment en Palestine. Après la Seconde Guerre mondiale, son mari disparu dans la Shoah, elle reprend courageusement sa vie d’hébraïsante militante, cherche à donner corps aux rêves d’écriture de sa jeunesse en écrivant pour la presse yiddish et voyage à nouveau, en Israël et en URSS, non sans nourrir une certaine amertume. Un destin singulier et représentatif à la fois de toute une génération de femmes immigrées d’Europe orientale.
/ From Russia to Paris: The Autobiography of an Immigrant and a Zionist, Rachel Hermann, 1887-1979
Born in the Ukraine, living in Paris since 1917, Rachel Hermann’s memoir was written late in life in Yiddish, and until now has remained in the private papers of her family. This article presents passages from its translation by Henry Bulawko, accompanied by a critical analysis. Thirsty for knowledge, as a member of Jewish intellectual circles in Odessa and a fervent Hebrew scholar, this Zionist provided for herself by giving private Hebrew lessons in Palestine in 1914-1915, then in Cairo and Paris, where she married Nahum Hermann, an active Zionist. At his side, she participated in the major events of Zionist and Jewish life in interwar Paris, volunteered for the “Union hébraïque mondiale” and travelled, especially to Palestine. After World War II, having lost her husband in the Shoah, she courageously took up her former life as a Hebrew activist and sought to fulfill the dream of her youth to write by contributing to the Yiddish press, and travelled again to Israel and the USSR, not without some bitterness. A destiny that was both singular and representative of an entire generation of Eastern European women immigrants.
L’émancipation de la femme juive nord-africaine dans les romans d’Élissa Rhaïs et de Blanche Bendahan, par Milena Pressmann
Dans l’émancipation des Juifs, les femmes occupent une place singulière. Grâce à l’école et à l’adoption des mœurs françaises, elles quittent peu à peu le rôle qui leur était traditionnellement imparti. Que ce soit dans les romans d’Élissa Rhaïs ou de Blanche Bendahan, la question de cette émancipation occupe une place déterminante. Entre doutes et espoirs, ces femmes écrivains évoquent une confrontation avec le défi de la modernisation et de l’occidentalisation apportées par la colonisation. Leurs analyses sont néanmoins différentes, voire paradoxales. Si Élissa Rhaïs a tendance à mettre le monde traditionnel sur un piédestal face à un monde occidental entaché de superficialité, la position de Blanche Bendahan reste plus ambiguë, peignant une héroïne écartelée entre ses racines tétouanaises et les valeurs de l’Occident, entrevues dans ses lectures. Tout en célébrant le mouvement d’acculturation qui touche le Maghreb à la fin du XIXe siècle, Blanche Bendahan paraît en souligner les limites, comme s’il fallait voir dans son œuvre, au-delà du bilan positif, une sorte de mise en garde quant à la violence, fruit du contraste des cultures et des mentalités, faite à ces femmes.
/ The Emancipation of the North African Woman in the Novels of Elissa Rhaiis and Blanche Bendahan
In the story of French Jewish emancipation, women occupy a very particular place. Thanks to schooling and to the adoption of French mores, they have moved progressively away from the roles traditionally assigned to them. In the novels of both Elissa Rhaiis and Blanche Bendahan, the question of emancipation occupies a critical role. Caught between doubt and hope, these women writers evoke the confrontation with the challenges of modernization and westernization that accompanied colonialism. Their analyses are nonetheless quite different, even paradoxical. Whereas Elissa Rhaiis has the tendency to put the traditional world on a pedestal and contrast it with a Western world blemished by superficiality, the position of Blanche Bendahan is more ambiguous, as she paints a picture of a heroine torn between her Tétouan roots and Western values. Even as she celebrates the movement towards French acculturation that touched the Maghreb at the end of the nineteenth century, Blanche Bendhahan emphasizes its limits. Beyond a positive assessment of those changes, we see in her novels a kind of warning about the violence done to these women by this confrontation between different cultures and mentalities.
Mélanges
Heurs et malheurs de l’entreprise immobilière Bernheim (c.1890-1945), par Michel Dreyfus
Cet article retrace la trajectoire de l’entreprise Bernheim, entre sa fondation à la fin du XIXe siècle par une fratrie « israélite » originaire de Lorraine et 1945. Jusqu’en 1914, l’entreprise a beaucoup loti en banlieue parisienne, transformant des grands domaines que leurs propriétaires ne pouvaient plus entretenir en zones pavillonnaires, généralement d’un certain standing. L’entre-deux-guerres voit l’extension de ses activités en province, conjuguant des opérations visant une clientèle plus populaire et des activités hôtelières de grand luxe, tandis qu’elle se dote d’une structure nationale. C’est alors que la deuxième génération des Bernheim accède au mécénat artistique. Pendant la guerre, l’« aryanisation économique » menée par l’occupant et Vichy représente évidemment un moment de crise, mais dont l’entreprise, sinon toujours les membres de la famille, a pu se relever.
/ The Saga of the Bernheim Real Estate Company (c. 1890-1945)
This article tells the story of the Bernheim Company, from its founding at the end of the nineteenth century by a group of Jewish brothers from Lorraine, up until 1945. Until 1914, the company operated for the most part in the suburbs of Paris, transforming large estates that their owners could no longer maintain into mostly high-end residential zones. The interwar period saw the extension of the company’s activities elsewhere in France, along with its expansion into housing projects geared towards more modest clients, as well as the luxury hotel business. This successful nation-wide expansion enabled the second-generation of Bernheims to become patrons of the arts. During the war, the ‘‘economic Aryanization’’ lead by the German occupiers and by Vichy inevitably lead to a crisis, but it was one from which the company—although not all the members of the family—were able to recover.
Faire de l’Europe un centre du judaïsme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Rêves et réalités, par Miriam Intrator
Inspirées par la demande pressante des survivants juifs d’Europe en matière de culture ainsi que par la mission dévolue à la toute nouvelle Unesco (encourager les collaborations et les échanges et la coopération transnationale et interculturelle), de nombreuses propositions émanèrent des milieux intellectuels juifs pour établir de nouvelles institutions juives culturelles transeuropéennes au lendemain immédiat de la seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste. La mission de l’Unesco, qui consistait à reconstruire, préserver et développer les droits et les institutions culturelles dans l’Europe dévastée par la guerre et au-delà, a créé un cadre dans lequel entretenir ces rêves d’échanges culturels internationaux juifs était non seulement possible après-guerre, mais essentiel pour reconstituer une Europe tolérante et tournée vers l’avenir. Au bout du compte toutefois, ces rêves cédèrent le pas devant la préférence de plus en plus accordée après la guerre au soutien à apporter aux nouveaux centres de la vie juive, hors d’Europe.
/ Dreams Versus Reality: Ideas to (Re)construct Europe as a Post-World War II Jewish Center
Inspired by the urgent demand to provide culture for surviving European Jewry as well as by the mission of the nascent Unesco to foster transnational and intercultural cooperation, collaboration and exchange, a number of proposals to establish new, transnational Jewish cultural institutions in Europe emerged within Jewish intellectual circles in the immediate aftermath of World War II and the Holocaust. Unesco’s dedication to reconstructing, preserving and developing cultural rights and institutions in war-devastated Europe and beyond created a framework in which such dreams of international Jewish cultural exchange emerging out of postwar Jewish Europe was not only possible, but essential to reconstituting a forward-looking and tolerant Europe. Ultimately, however, such dreams were subsumed by a reality in which the postwar focus turned increasingly to supporting the new centers of Jewish life, outside of Europe.
Dictionnaire
- Israël Stora, commerçant, président des consistoires de Constantine et d’Alger (Alger, 1825 – Saint-Eugène, 26 février 1894), par Valérie Assan
- Israël, dit Nahum Hermann, journaliste, sioniste et résistant (Chargorod (Ukraine), 2 ou 10 janvier 1889 – Auschwitz, 10 mars 1944), par Catherine Nicault
- Émile Meyerson, philosophe des sciences et palestinophile (Lublin, 12 février 1859 – Paris, 2 décembre 1933), par Eva Telkes-Klein
- Robert Halbronn, ingénieur et aviateur (Paris, 27 décembre 1890 – Toussus-le-Noble, 3 septembre 1918), par Patrick Bessas
Lectures
Olivier Lalieu, Histoire de la mémoire de la Shoah, Paris, Éditions SOTECA, coll. « Histoire de la mémoire » dirigée par Serge Barcellini, 2015

