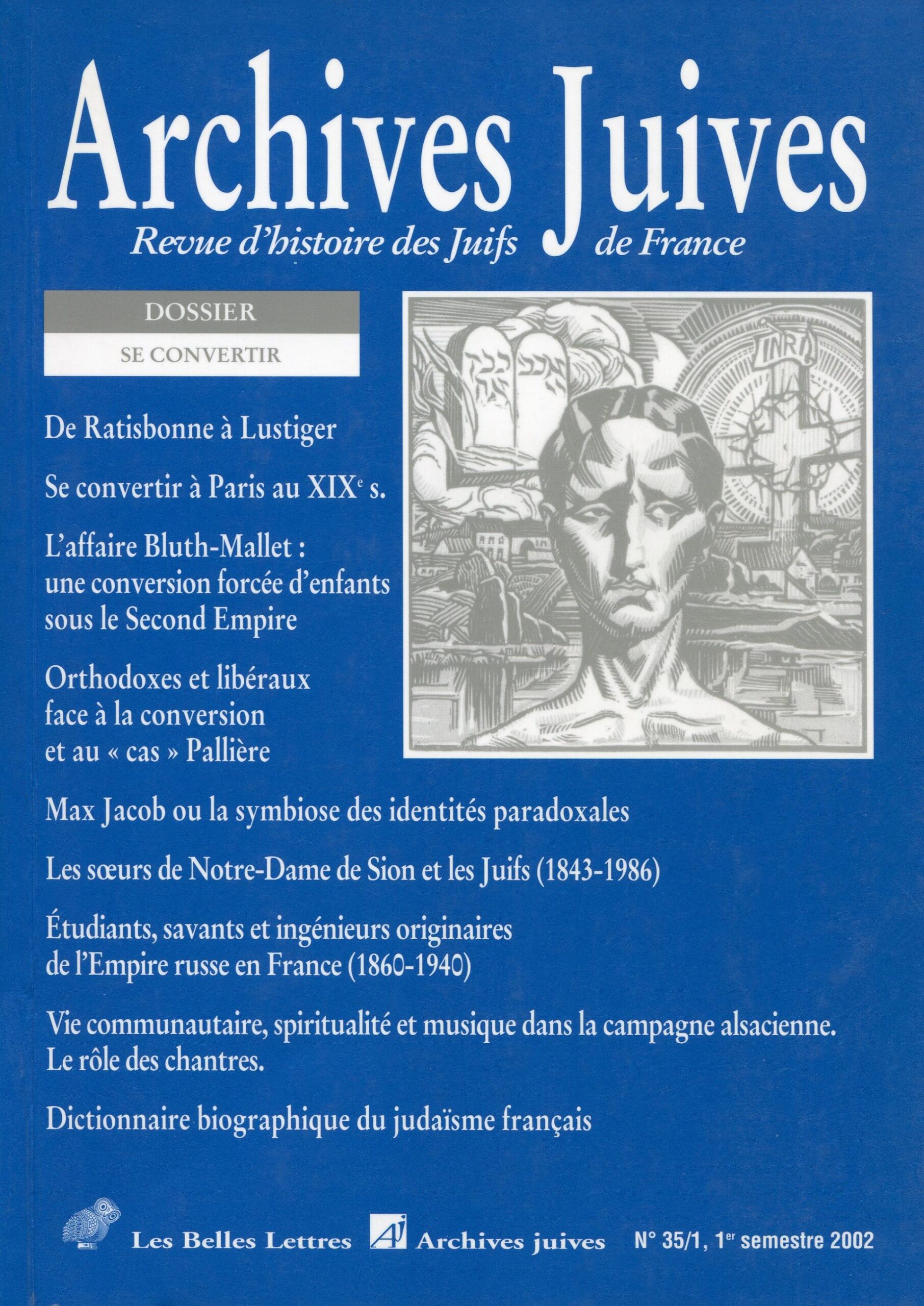
Découvrir
Éditorial
Archives juives propose à ses lecteurs un dossier important et passionnant. Les Juifs sont entrés dans la communauté française en 1790 et 1791. Napoléon Ier a mis sur pied une architecture consistoriale qui assure au culte israélite l’égalité vis à vis de l’État avec les autres cultes. Désormais, la voie de l’intégration est largement ouverte. Débouchera-t-elle sur l’assimilation totale ? En un mot, puisque les Juifs sont devenus des israélites, ne devraient-ils pas aller jusqu’au bout du chemin, renoncer à leur identité religieuse pour adopter la religion dominante et se fondre dans la masse des catholiques ? Sans doute la question est-elle posée avec une brutalité qu’évitaient les hommes et les femmes du XIXe siècle et plus encore celles et ceux du XXe siècle. Mais, discrète, persistante, elle reste présente.
Toutefois, quels que soient les motifs qui l’inspirent, la conversion ressemble à un arrachement. C’est le rejet volontaire du passé, l’entrée dans une nouvelle communauté, l’adoption d’une autre histoire. Elle peut signifier le retour à la religion de la part de ceux qui n’ont reçu aucune instruction religieuse et découvrent soudain leurs aspirations spirituelles. Elle peut aussi résulter d’une contrainte, physique ou morale. Elle demeure, malgré tout, le danger majeur qui menace toute minorité, même s’il arrive que des catholiques ou des protestants se convertissent au judaïsme ou s’en rapprochent. Toute minorité craint de disparaître. La conversion est une disparition « douce ». Elle n’en est pas moins redoutable, surtout lorsque des personnalités déterminées, des institutions puissantes s’emploient à convertir. Le judaïsme français a connu sa période de doutes, traversé la mer des périls, vécu des crises profondes ou superficielles.
Nous sommes conscients qu’en traitant de cette délicate question, nous heurterons des sensibilités, nous ne parviendrons pas à épuiser le sujet et nous échouerons à retranscrire des réalités complexes, souvent individuelles, toujours difficilement saisissables. Mais le jeu en vaut la chandelle. L’histoire que nous proposons n’est pas définitive. Elle ne vise certainement pas à imposer des conclusions auxquelles il serait interdit de toucher. Tout au contraire. Comme dans les numéros antérieurs, nous souhaitons stimuler la recherche. C’est pourquoi nous ne limitons pas nos efforts au dossier. Nous publions aussi une étude sur les étudiants, les savants et les ingénieurs juifs d’origine russe, une analyse de la spiritualité et de la musique dans la vie communautaire de la campagne alsacienne. Nos rubriques habituelles complètent le numéro. Je tiens, à ce propos, à souligner que notre dictionnaire progresse à grands pas. Les notices biographiques sont maintenant nombreuses. D’autres attendent d’être soumises aux lecteurs. Il sera temps, dans les prochains mois, d’envisager de les rassembler dans un volume. Ce sera, à n’en pas douter, l’un des apports majeurs des Archives juives.
A.Kaspi
Sommaire
Dossier : Se convertir
Conversions et apostasies. Quelques mots d’introduction, par Frédéric Gugelot
Pas de résumé disponible pour l’instant.
De Ratisbonne à Lustiger. Les convertis à l’époque contemporaine, par Frédéric Gugelot
Interrogation posée depuis l’apparition du christianisme à l’identité juive, la conversion a toujours été et reste perçue et vécue comme une trahison par les Juifs, qu’ils soient religieux ou non. L’attitude du converti à l’égard du judaïsme originel a, lui, profondément évolué en Europe occidentale depuis l’Emancipation : les convertis du XIXe siècle inscrivent leur parcours, à l’instar des frères Ratisbonne, dans un rejet du judaïsme de croyance et de condition, voire dans une haine de soi ; au XXe siècle, on les voit d’abord osciller entre rejet de la foi juive et revendication de la judéité, puis, après 1945, affirmer, à l’instar de Jean-Marie Lustiger, leur double appartenance. Une évolution dont l’origine est à chercher dans les mutations mêmes du judaïsme comme dans le changement des perceptions survenues dans le camp chrétien.
/ From Ratisbonne to Lustiger. Converts during the Contemporary Period
A permanent problem for Jewish identity, as soon as Christianism existed, rhe conversion has always been felt and lived, and still is, as a treason by the Jews, be they religious or non religious. The outlook of the convert toward his » native » Judaïsm, has deeply evolved since the time of the Emancipation in Western Europe. During the XIXth century, converts, following the Ratisbonne brothers, chose to change religion because they refused the Jewiqh faith and way of life and even because of self-hatred. During the XXth century, they first wavered between rejecting the Jewish belief and asserting their belonging to Jewishness, then, after 1945, they have claimed their belonging both to Christianism and Judaïsm. Their evolution can be traced back to the changes in Judaïsm itself and also to the new outlook of Christianity.
Se convertir à Paris au XIXe siècle, par Philippe-Efraïm Landau
Fruit d’une recherche originale dans les archives des institutions religieuses de la capitale, l’article cerne d’abord les effectifs exacts des Juifs parisiens qui, de 1807 à 1914, abjurent pour rejoindre les rangs catholiques, mais aussi ceux des chrétiens qui, dans ce même laps de temps, se convertissent au judaïsme. D’où il ressort que si environ 1 000 israélites sont alors devenus catholiques, près de 500 chrétiens ont choisi de devenir juifs. Le judaïsme n’a donc pas subi de réelle hémorragie du fait de la conversion, qui ne constitue qu’un aspect très marginal de la déjudaïsation. L’étude fine des flux de conversions selon les périodes, le sexe, l’âge et les milieux se double d’une analyse des motivations parmi lesquelles le mariage joue un rôle manifestement majeur, tout particulièrement dans les cas de conversion au judaïsme.
/ To get converted in Paris during the XIXth century
Resulting from a specific quest among the archives of the religious institutions in Paris, this article first figures out the correct numbers of Jews in Paris who, from 1807 to 1914, forswore their own faith and converted to Catholicism, as well as the number of Christians who converted to Judaïsm during the same period. From this research we can make out that while 1 000 Jews became Catholics, nearly 500 Catholics turned to the Jewish religion. Then Judaïsm did not such a dramatic drain because of conversion, which comes in fact as a minor reason in the losses of Judaïsm. The accurate analysis of the ebb and flow of conversions according to periodes, sex, age and social classes goes together with a study of the motives among which mariage comes widely ahead, especially when dealing with conversion to Judaïsm.
L’intégration par la liberté des consciences et l’égalité des cultes. L’exemple de l’affaire Bluth-Mallet (1861), par Danielle Delmaire
En 1861 le chanoine Mallet du diocèse de Cambrai comparait devant la justice pour enlèvement d’enfants juifs et conversion sans l’accord des parents. A cette occasion, le pouvoir civil et le pouvoir religieux s’opposent. L’un défend la liberté des consciences et le droit des parents, l’autre prétend agir pour le salut des âmes. Dans le contexte de l’affaire Mortara en Italie et de la création de l’Alliance israélite universelle, les Juifs de France ont alors le sentiment d’avoir obtenu, avec la condamnation de Mallet, la liberté des cultes.
/ Integration through Freedom of Conscience and Religion. The Example of the Bluth-Mallet Case (1861)
In 1861, canon Mallet, from Cambrai diocese, is put to trial under the accusation of abduction of Jewish children and their conversion without theit parents’ assent. On this matter, the public authority and the religious one have totally conflicting opinions. The first one stand for the freedom of conscience and the rights of the parents, while the other side claims that it works for the salvation of souls. With the occurrence of the Mortara case in Italy and the birth of the Alliance israélite universelle, the Jews of France become then aware that after Mallet was sentenced, they have gained freedom of religion.
Autour du « cas » Pallière. Débats sur la conversion entre Juifs orthodoxes et libéraux, par Catherine Poujol
L’article étudie le « cas » particulier d’un chrétien, Aimé Pallière, qui tente de se convertir au judaïsme entre 1895 et 1924. Le refus, en 1895, du rabbin Benamozegh fait de lui le propagateur d’une nouvelle religion, le » noachisme « . Devenu un journaliste connu, moderniste et dreyfusard, la conversion lui est refusée dans un contexte antisémite qui fait reculer le rabbinat par crainte du scandale en 1908. Réformateur, à l’origine de l’Union libérale israélite, il devient le prédicateur de la synagogue de la rue Copernic en 1922. La circoncision ayant été supprimée dans ce cercle depuis 1914, il peut alors se croire converti. Mais un scandale éclate à ce sujet qui, paradoxalement, va vider l’abcès. Un accord signé en 1924 donne un statut respectable à l’Union libérale qui avait rompu avec le Consistoire central depuis 1907.
/ About Pallière « case » : a Debate on Conversion between the Ortodox Jews and the Liberal ones
The article deals with the pecular example of a Christian, Aimé Pallière, who endeavours to get converted to Judaïsm between 1895 and 1924. The refusal, in 1895, of rabbi Benamozegh leads him to turn to a new religion : » noahism « . He became a renowned journalist, a supporter of Dreyfus, but because of the antisemitic environment, in 1908, the rabbinate refuses to grant him conversion for fear or scandal. A Reformer, a member among the creators of the Union libérale israélite, he becomes a preacher for the Copernic Synagogue in 1922. As circumcision has been dismissed from this synagogue as early as 1914, he considers himself as a convert. A controverse bursts about this problem, and, oddly enough, this will to the final decision that an agreement dated 1924 grants the Union libérale a respectful status, although the Union had brooken off with the Central Consistory in 1907.
Max Jacob ou la symbiose des identités paradoxales, par Catherine Fhima
Max Jacob est une figure singulière parmi les convertis issus du judaïsme au début du XXe siècle. Juif, breton, poète et peintre parisien à l’esthétique avant-gardiste, acteur du cubisme et du premier surréalisme, homosexuel, converti, catholique de Saint-Benoit, écrivain catholique, » martyr » juif : autant d’identités désirées, rejetées, assumées, dépassées, se côtoyant, s’annulant, à la fois parallèles et contradictoires, assignées par le regard des autres ou autoproclamées. Des identités enchevêtrées donc, autour desquelles il s’agit d’articuler quelques réflexions, de jeter quelque lumière peut-être, pour tenter de répondre aux multiples questions plus globales que cette trajectoire pose, du point de vue de l’histoire des identités dans le contexte de la modernité française de la première moitié du XXe siècle.
/ Max Jacob or the Symbiosis of Paradoxical Identities
Max Jacob appears as a peculiar character among the converts from Judaïsm in the begenning of the XXth century. A Jew, an avant-gardist poet and painter in Paris among the first cubists and surrealists, a homosexual, a convert, catholic from Saint-Benoît, a catholist writer, a Jewish » martyr » : so many identities proclaimed, denied, assumed and transcended, which add or cancel one another, similar as well as conflicting, attributed by others or self-proclaimed. As such they are intermingled identities which need some thinking over in order to throw some light upon the numerous questions about this particuliar path, when dealing with the history of identities in the frame of the French modernity in the first half of the XXth century.
De la conversion à la rencontre. Les religieuses de Notre-Dame-de-Sion (1843-1986), par Madeleine Comte
Fondée en 1843 par des Juifs convertis, les frères Ratisbonne, la congrégation des religieux de Notre-Dame-de-Sion se voue à la prière pour la conversion des Juifs ainsi qu’à l’aide aux plus défavorisés d’entre eux. Sa réussite dans l’enseignement estompe ensuite cette spécificité. Lorsque, de 1940 à 1944, s’abat la persécution sur les Juifs de France, un certain nombre de religieuses oeuvrent courageusement pour les sauver. Au même moment, de nombreux baptêmes sont célébrés dans leur chapelle de Paris. Peut-on parler de prosélytisme ? Après la guerre et l’affaire Finaly, la congrégation prend un tournant décisif ; elle ne se contente pas de suivre, elle accompagne et parfois stimule l’évolution de l’Eglise catholique qui aboutit en 1965 au document conciliaire Nostra Aetate et qui se poursuit depuis. Dorénavant, les religieuses de Sion travaillent à la connaissance et à la rencontre du judaïsme et des Juifs d’aujourd’hui.
/ From conversion to encounter. The nuns of Notre-Dame de Sion (1843-1986)
Founded in 1843 by converted Jews, the Ratisbonne brothers, the congregation of Notre-Dame de Sion was devoted to prayer for the conversion of Jews and to helping the most disadvantaged among them. Afterwards, it turned to education for which task it was very successful. From 1940 to 1944, when the Jews in France met with persecution, some nuns endeavoured bravely to save them. At the same time, numerous christenings are celebrated in their chapel in Paris. The question is : is this proselytism ? After the war and the Finaly case, the congregation chooses an important turning-point ; it is not merely satisfied with following the Church, it takes part and even stimulates the change of the Catholic change which ends in a conciliatory document in 1965, Nostra Aetate, which is still valid. Henceforward, the nuns of Sion endeavour to get a better knowledge and encounter with Judaïsm and to-day Jews.
Mélanges
Etudiants, savants et ingénieurs juifs originaires de l’Empire russe en France (1860-1940), par Irina et Dimitri Gouzevitch
Les auteurs ont dépouillé les archives des écoles supérieures techniques, des universités et des institutions de recherche en France pour dresser un premier tableau statistique et une esquisse de typologie de la population estudiantine d’origine juive russe. Son nombre reflète les évolutions de l’histoire des Juifs en Russie, et de l’Europe entrée dans la Grande Guerre ; la proportion de femmes, encore plus brimées que les hommes pour l’accès aux études supérieures dans leur pays d’origine, y est particulièrement importante. Pour certains de ces étudiants, ce n’est qu’une » couverture » de leurs activités politiques, la plupart cependant sont mus par le désir d’acquérir un métier. Leur destinée ultérieure est extrêmement diverse.
/ Jewish students, scholars and engineers coming to France from the Russian Empire (1860-1940)
The authors went through the archives of professional training colleges, universities and research institutes in France in order to draw ut the first statistical tables ans specific picture of the Jewish students coming from Russia. The number of this population accounts for the changes in the history of the Jews in Russia and of Europe on entering the first World War ; women are particularly numerous, whereas in their birth country they were far more debarred the right to have access to university than the men. For some of theeese students, university was merely a blind for their political action, but for the majority it meant a longing to become true professionals. What befell them subsequently varied widely.
Vie communautaire, spiritualité et musique dans la campagne alsacienne. Le rôle des chantres, par Claude Heymann
Les chantres de la campagne alsacienne incarnent tout un pan du judaïsme rural alsacien aujourd’hui disparu. Notables importants et personnages » bon enfant » de communautés la plupart du temps réduites, ils tiennent un rôle central dans l’économie humaine de ces groupes sociaux. Les chantres sont tantôt les gardiens d’une tradition liturgique spécifique – et à ce titre fort critiqués dans les villes – tantôt les initiateurs de changements qui, dans le cadre de la halakha, permettent à l’espace synagogal de rester le pivot de la vie communautaire. Souvent leur » aura » artistique dépasse le cercle de la communauté juive et d’étend aux mélomanes locaux.
/ Community Life, Spirituality and Music in the Alsacian Countryside. The Part played by the Cantors
The cantors in the alsacian countryside stand for an important aspect of the alsacian rural Judaïsm, which no longer exists to-day. Seen as main notabilities or » easy-going » men among very often small communisties, they play the main part in the human organization if these social groups. The cantors may have been the keepers otf a specific liturgical tradition -and as such most criticized by the urban Jews – or they may have been the firts to initiate changes which, respecting the halakha, allow the synagogal surrounding to remain the axis of communautory life. Very often, their artistic renown reaches, beyond the circle of the Jewish community, the local music-loving people.
Dictionnaire
- Elie-Aristide Astruc, rabbin, écrivain et publiciste (Bordeaux, 1er décembre 1831 – Bruxelles, 23 février 1905)
- Mark Vichniak, juriste et militant socialiste-révolutionnaire,
- Berthe Weill, galeriste
Lectures
- Joseph Shatzmiller, Shylock revu et corrigé. Les Juifs, les chrétiens et le prêt d’argent dans la société médiévale (Monique Lévy)
- Société d’histoire des israélites d’Alsace et de Lorraine, XXIe colloque (Monique Lévy)
- Françoise Basch, Liliane Crips, Pascale Gruson dir., Victor Basch 1863-1944 : un intellectuel cosmopolite (Philippe Moine)
- Madeleine Comte, Sauvetages et baptêmes. Les religieuses de Notre-Dame-de-Sion face à la persécution des Juifs en France (1940-1944) ( Frédéric Gugelot)
- Georges Weill, Emancipation et progrès, l’Alliance israélite universelle et les Droits de l’homme (Katy Hazan)

