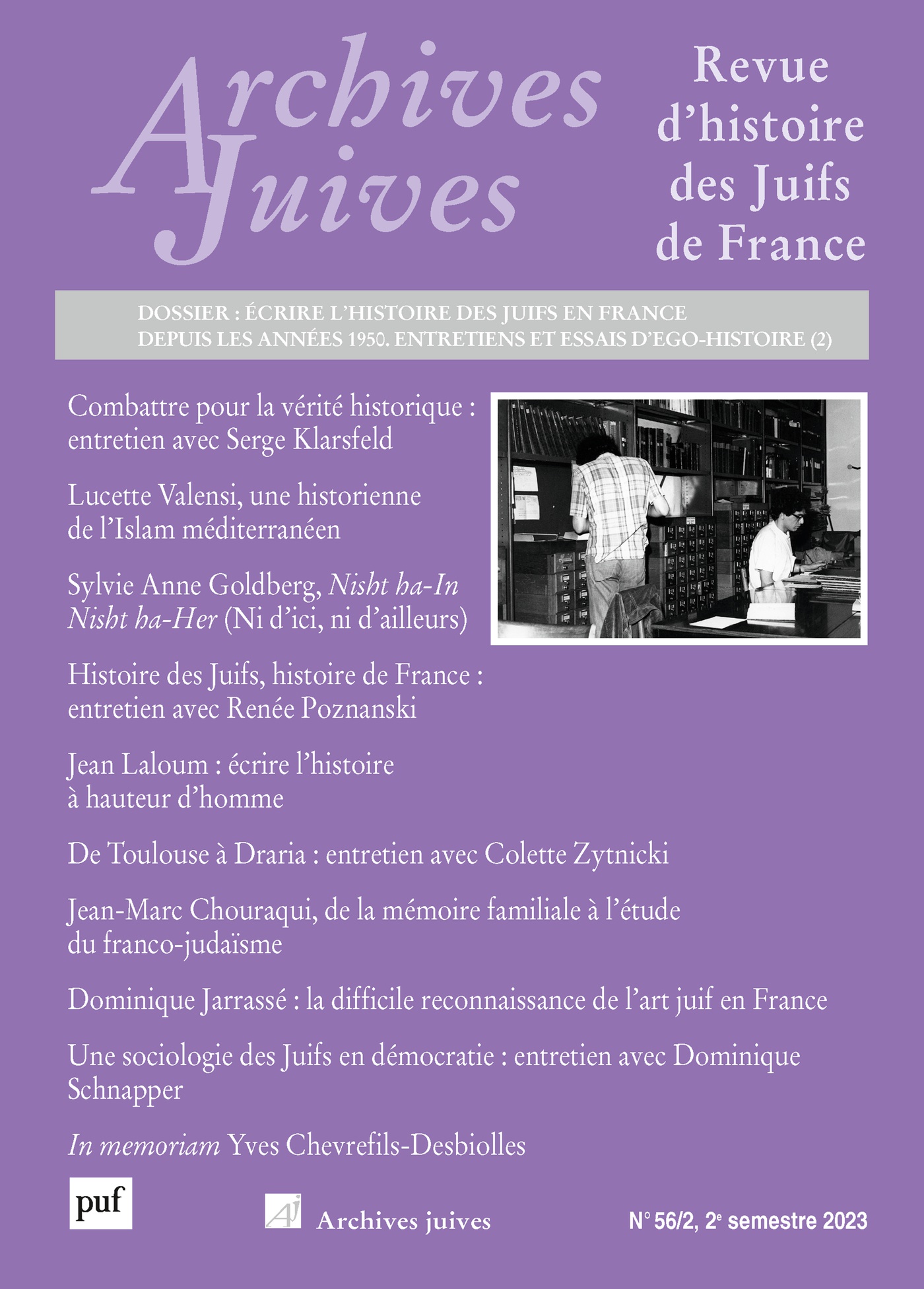
Découvrir
Éditorial
Dès la préparation, en 2022, d’un premier dossier consacré à l’écriture de l’histoire des Juifs en France, la nécessité d’un second volet s’était imposée à la rédaction d’Archives juives comme une évidence. C’est chose faite avec ce nouveau numéro. Une spécialiste confirmée des écritures historiennes, l’universitaire Isabelle Lacoue-Labarthe, s’est chargée de la coordination de ce dossier d’ego-histoire tout aussi ample et foisonnant que le précédent.
Si l’histoire « avec sa grande hache » compte incontestablement dans le choix fait par plusieurs générations d’historiens de dédier au moins une partie de leur carrière aux études juives, bien d’autres facteurs, décryptés avec un soin particulier dans les contributions qui suivent, entrent également en jeu. Au-delà des trajectoires individuelles qu’ils retracent, les récits autobiographiques et les entretiens croisés qui composent ce dossier donnent à voir quelque chose qui les dépasse. Ils constituent des documents pour saisir au prisme de diverses subjectivités des événements, mais aussi un air du temps, des changements imperceptibles qui définissent une époque. Au fil des textes, se dessine également une géographie intellectuelle à travers l’évocation des bibliothèques – et des bibliothécaires, auxquels il est rendu hommage dans plusieurs articles –, des centres d’archives, des laboratoires de recherche et des établissements d’enseignement supérieur où l’histoire des Juifs de France s’est écrite et continue à s’élaborer. En replaçant ces témoignages dans la constellation des écrits autobiographiques d’historiens, Isabelle Lacoue-Labarthe attire notre attention sur les enjeux, les codes et les variations de ce qui est devenu un genre littéraire à part entière. Que tous ceux qui se sont prêtés, dans le cadre de ce numéro, à cet exercice d’autoréflexivité sur leur parcours intellectuel soient ici remerciés !
L’histoire des Juifs est-elle un sport de combat ? Oui, assurément, affirment ou laissent entendre plusieurs contributeurs de ce dossier. Un combat pour établir la vérité historique, contre le négationnisme, contre l’antisémitisme. Ce numéro est aussi l’occasion de rappeler que l’histoire des Juifs en France n’est pas seulement l’affaire des Juifs et qu’elle ne se limite pas à l’histoire de la Shoah. Parce que les Juifs furent présents dans l’espace hexagonal dès l’époque médiévale, et même antérieurement, et dans la mesure où, bien avant leur émancipation politique et leur intégration, ils entretinrent des relations constantes avec les « gentils », l’histoire des Juifs en France fait partie de l’histoire française et européenne dans toutes ses dimensions. L’histoire des Juifs doit être aussi, comme c’est de plus en plus souvent le cas, pleinement incluse dans l’histoire universelle.
Au moment où ce numéro partait chez l’éditeur, nous apprenions la brutale disparition d’Yves Chevrefils Desbiolles. Historien de l’art, ancien responsable des fonds artistiques à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Yves participait avec enthousiasme et générosité à la vie d’Archives juives en tant qu’auteur et membre du comité de rédaction. Son érudition, son amour du beau, sa bienveillance nous manquent cruellement. Ce volume est dédié à sa mémoire.
V.Assan
Sommaire
Dossier : Écrire l’histoire des juifs en France : Entretiens et essais d’égo-histoire (2)
Quand les historiens des Juifs de France se racontent. Introduction, par Isabelle Lacoue-Labarthe
Ce nouveau dossier d’Archives juives s’inscrit dans le prolongement du no 55/1, paru en 2022 et consacré à l’écriture de l’histoire des Juifs en France depuis les années 1950. Les textes qui suivent viennent affiner, compléter, apporter d’autres couleurs à ce premier tableau de groupe transcendant les récits individuels ; en cela, ils s’inscrivent dans la vague sinon initiée, du moins renforcée par l’historien Pierre Nora à travers les Essais d’ego-histoire .
Les écrits autobiographiques d’historiens et, plus largement, de chercheurs en sciences humaines et sociales, se multiplient en effet en France depuis la fin des années 1970 et surtout des années 1980 ; l’un des premiers historiens à en produire un est René Rémond ; dès 1978, Michel Winock parsème La République se meurt de souvenirs personnels et d’histoire familiale ; puis en 1980, Philippe Ariès publie Un historien du dimanche. Avant de rendre sa contribution à l’ouvrage dirigé par Pierre Nora évoqué précédemment, Georges Duby retrace son itinéraire au cours d’entretiens avec Guy Lardreau. En 1982, Emmanuel Le Roy Ladurie évoque ses années d’engagement politique au sein du Parti communiste français puis du Parti socialiste unifié, comme le fait quelques années plus tard Alain Besançon. Le tournant des années 1990 voit s’abattre une véritable avalanche de nouveaux récits : Pierre Chaunu – à plusieurs reprises –, Raoul Girardet, Georges Duby et Jacques Le Goff – qui prolongent leur récit d’ego-histoire –, Annie Kriegel, Pierre Goubert, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet et même Jean-Pierre Vernant acceptent de se raconte…
/ English summary not yet available.
Combattre pour la vérité historique : entretien avec Serge Klarsfeld
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ Fighting for the historical truth: an interview with Serge Klarsfeld
Interviewed by historian Laurent Joly, Serge Klarsfeld revisits his career as an activist and historian. With his wife Beate Klarsfeld, he was notably at the initiative of the proceedings intended against Kurt Kiesinger, Herbert Hagen, Kurt Lischka, Klaus Barbie, Jean Leguay and René Bousquet. As a historian, he has contributed, thanks to his exploration of numerous archives, to the establishment of the responsibility of the Vichy regime in the deportation of the Jews of France.
Un parcours d’historienne : avais-je vraiment le choix ? par Lucette Valensi
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ A historian’s itinerary: did I really have a choice?
Responding to an invitation to reflect on my career as a historian who, since the 1970s, has been working on the experience of North African Jews, I highlight three factors: 1°) Social-political determinations, consequent to my experience as a young Jewish person in a Muslim country under French rule. 2°) The position I attained in my field of social history inspired by anthropology. 3°) The intellectual circumstances of the 1970s in France, when Jewish studies became a legitimate field in the social sciences.
Nisht ha-in, nisht ha-her (ni d’ici, ni d’ailleurs), par Sylvie Anne Goldberg
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ Nisht ha-in, nisht ha-her (neither from here nor from elsewhere)e Klarsfeld
In this text, Sylvie Anne Goldberg returns to some of the salient elements on which she has built her approach to Jewish history, trying to take into account her origins and the decade in which she was born in Paris. From her first research on the Jews of Paris in the 18th century to her work on conceptualizations and attitudes towards illness, death, and time, she attempts to take stock of her historical practices, the methodological framework she has constructed, and the pitfalls she has had to overcome in working on Jewish history.
Pour une histoire des Juifs intégrée à l’histoire de France : entretien avec Renée Poznanski
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ For a history of the Jews integrated into the history of France: an interview with Renée Poznanski
Renée Poznanski was born in Paris in 1949 and in 1973 she moved to Israel, where she has pursued her academic career while maintaining close ties with France. Professor emeritus at Ben Gurion University of the Negev, she is a specialist in the history of the Shoah and of Jews in France during the Second World War. In this interview, she revisits the evolution of her research work.
Écrire l’histoire à hauteur d’homme, par Jean Laloum
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ Writing history from a micro-historical perspective
In this text, historian Jean Laloum looks back on his career as a committed researcher. From his master’s thesis on anti-Semitic propaganda in France in 1940-1944 to his doctoral dissertation on the Jewish world in the eastern suburbs of Paris and his habilitation on the policy of economic Aryanization in Algeria, Jean Laloum has not ceased to contribute, by following a micro-historical approach, collecting countless photographs and conducting numerous interviews, to shedding light on the fate of the Jews and their daily life during the Second World War. Complemented by his involvement in the association Mémoires Juives – Patrimoine photographique and the Conseil du patrimoine privé de la ville de Paris, Jean Laloum’s work has also led to the affixing of a plaque to the façade of the former UGIF children’s home in Montreuil in memory of the deported children and teachers, a pioneering step that paved the way for municipal policies in this area.
De Toulouse à Draria et retour (provisoire) à Paris : entretien avec Colette Zytnicki
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ From Toulouse to Draria and back (temporarily) to Paris: interview with Colette Zytnicki
In this interview, Colette Zytnicki retraces her career as a historian from her first steps with a master’s degree under the direction of Robert Mandrou to her latest book. Through personal questioning and professional encounters, she focused on the history of the Jews in France and in the Maghreb in the contemporary period, and then on the history of colonial Algeria seen from different angles (the history of tourism, that of a village during colonization, or that of the earliest days of French colonization in Algeria). Her latest work revisits the history of the Jews in France with the biography of Madame Straus, who was at the center of one of the important salons of the Belle Époque, a dreyfusard salon.
Ego-histoire, Lego-histoire : de la mémoire familiale à l’étude du franco-judaïsme, par Jean-Marc Chouraqui
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ Ego-history, Lego-history: from family history to the study of Franco-Judaism
Jean-Marc Chouraqui identifies himself as belonging to the first generation of researchers who, in the 1980s, succeeded in entering university specifically as specialists in Jewish studies. He recounts the influence of his family background on his interest in history, particularly his father’s enrollment in the Leclerc Division during the Second World War, and his maternal grandfather’s denunciation of “Gaullism.” His parents’ strong republican tradition and his discovery of Jewish tradition led him to accept the subject, which was initially the subject of his doctoral thesis, suggested by his “mentor” in Jewish History, Gérard Nahon, on “Rabbinic Discourse and Political Emancipation in 19th-Century France.” He had previously written a postgraduate thesis on “Catholicism and Popular Religion in Provence” with Michel Vovelle. This dual approach to the religious phenomenon contributed to Professor Chouraqui’s election to the first post in History of Judaism in a “classic” university, in Aix-en-Provence.
De la marginalité et des origines : la difficile reconnaissance du patrimoine et de l’art juifs en France, par Dominique Jarrassé
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ About marginality and origins: the difficult recognition of Jewish heritage and art in France
For personal reasons, I wished to enter into Jewish culture as an architectural historian, the simplest way for me to launch a research project on the synagogues of France, which was a completely neglected topic, due to prejudices and a sclerosis of academic thought. This was exciting because it required adapting the discipline to my subject that did not fit into its usual frameworks… Hence the recourse to anthropology and a profound revision of the methodological and categorical foundations of an art history that made no room for synagogues or Jewish art. My work has taken the form of books, exhibitions, and conferences, in order to get this heritage recognized, even in Jewish circles, but also with an involvement in its safeguard and its transmission, as in the recognition of certain actors or collectors. Such an approach could not but lead to a reflection on identities.
Une sociologie des populations juives en démocratie : entretien avec Dominique Schnapper
Voir le résumé en anglais ci-dessous.
/ A sociology of Jewish populations in a democracy: an interview with Dominique Schnapper
In this interview, sociologist Dominique Schnapper, Professor Emeritus at the École des hautes études en sciences sociales (EHESS), looks back on her teaching and research career and on her positions at the head of several institutions. As a former member of the Conseil constitutionnel, President of the musée d’Art et d’histoire du judaïsme, and President of the Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, the sociologist has included Jews throughout her career in her sociological reflection on democracy, as, in her opinion, minorities, particularly the Jewish minority, are particularly relevant objects for analyzing the functioning of democratic societies.
In memoriam
Entre appels de l’Italie et Orient de l’esprit, Yves Chevrefils-Desbiolles (1951-2023), par Dominique Jarrassé
Né en Extrême-Occident (si l’on accepte encore que le centre de référence est l’Europe), Yves Chevrefils-Desbiolles a connu les « appels de l’Italie » et poursuivi à sa manière un « Orient de l’esprit », expressions empruntées à Waldemar-George, cet étrange critique auquel il s’est attaché, malgré ses ambiguïtés, voire la complexité de sa pensée, ou peut-être à cause de la complexité même d’un personnage aux identités riches et aux idéaux humanistes, mais parfois égaré dans les méandres du xx e siècle. Indéniablement fasciné par le monde méditerranéen, Yves paraît s’être aussi construit un lien spirituel avec un Orient spirituel.
Quelques jours après sa disparition, je souhaite me souvenir d’Yves sur le mode de l’amitié et de la complicité intellectuelle ; aussi suis-je reconnaissant à l’équipe d’Archives juives, une revue dont il était un collaborateur assidu, de me permettre d’évoquer sa mémoire, librement, d’exprimer, sans souci de convenance académique, mon amitié pour lui et pour Annie.
Assurément, d’autres sont plus à même de retracer sa carrière de chercheur, car ils ont collaboré à ses projets éditoriaux, l’ont côtoyé dans des comités de revues, ont suivi son parcours de plus près, peut-être échangé avec plus de fréquence sur des questions qui étaient au centre de ses recherches. Ainsi ses collègues d’Ent’revues ont déjà exprimé leur tristesse après la disparition de leur « compagnon d’une longue route ». Avec eux, il œuvra dès les années 1990 dans le champ de l’histoire des revues, où il fut pionnier avec sa thèse sur « Les revues d’art de l’entre-deux-guerres à Paris » (soutenue à l’Université Paris 1 dès 1992), et qui devint une de ses principales spécialités. Certes, il convient de rappeler que c’est à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) qu’il eut la chance de concilier ses intérêts pour l’art, les revues et le débat intellectuel, en devenant responsable des archives artistiques, et que c’est là qu’il put découvrir nombre de sujets pour ses études et travailler sur des fonds inédits où il savait dénicher des perles ; mais peut-être faut-il insister davantage encore sur une dimension de son travail : mettre à disposition des instruments de recherche – ainsi, la première version de son ouvrage Les Revues d’art à Paris 1905-1940 (Ent’revues, 1993) – et se mettre au service des chercheurs qu’il recevait à l’abbaye d’Ardenne, où sont rassemblées les collections de l’IMEC, un lieu tout chargé d’histoire, de sérénité studieuse, voire de spiritualité, et dont il aura été un des chanoines… Une forme d’altruisme qui eût été aussi profitable à l’Université si elle avait jugé bon de l’intégrer : mais, personnalité atypique, creusant des sujets que l’histoire de l’art tend souvent à déconsidérer parce que trop « littéraires », parce que la critique d’art ne serait pas de l’art, etc., il n’y est pas entré ; or il tenait – à tort – l’Université en haute estime et mettait parfois en doute ses propres compétences, modestie déplacée, car il a pu développer des travaux d’une qualité qui dépasse celle de bon nombre de chercheurs estampillés.
/ English summary not yet available.

