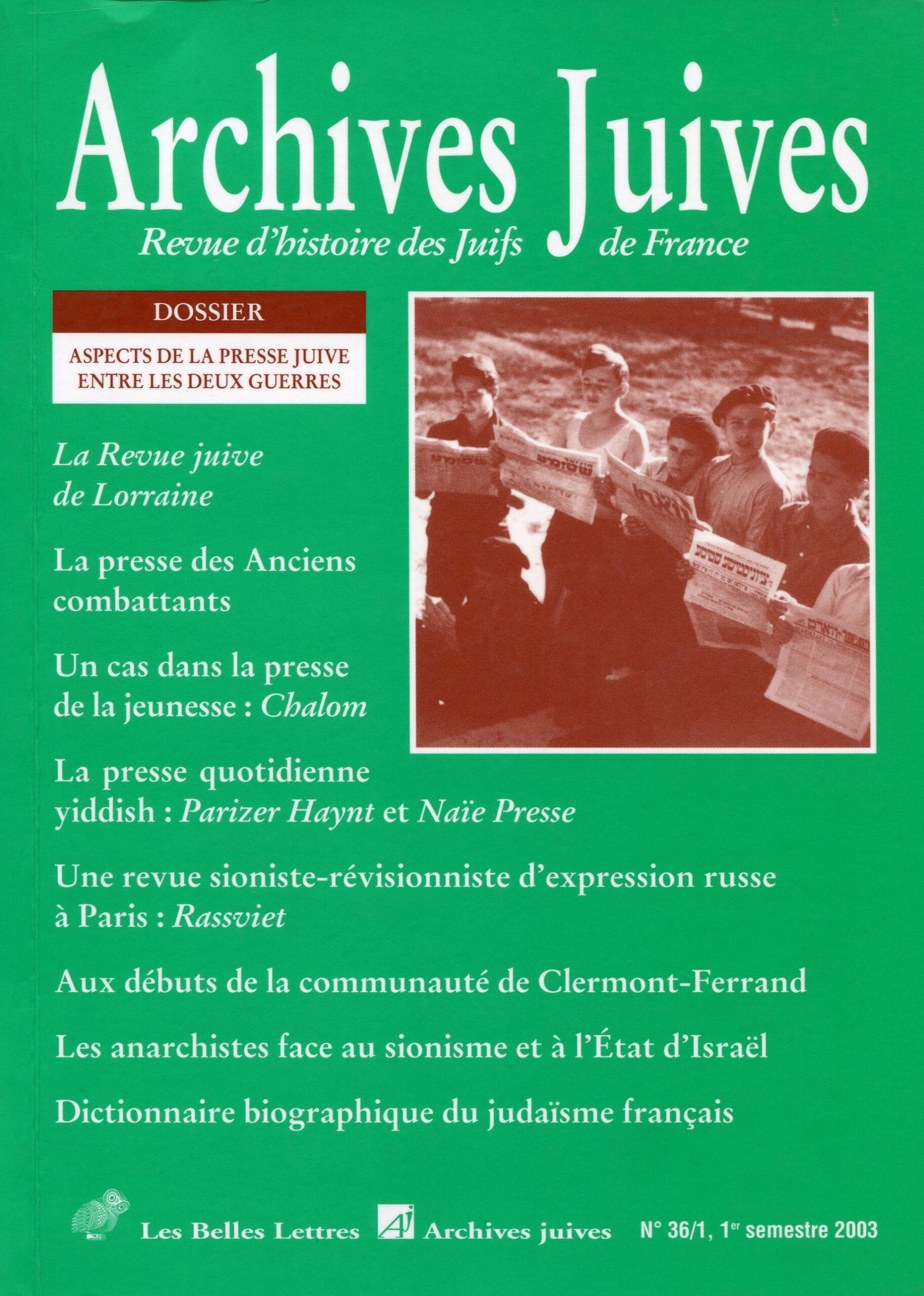
Découvrir
Éditorial
Pourquoi s’intéresser à la presse juive ? D’abord pour sa variété et sa richesse. Comme toutes les communautés, les Juifs en France ont développé une presse à usage interne, permettant la diffusion d’informations et la création ou le maintien d’un lien social. Pas moins de 374 titres entre 1789 et 1939, à en croire l’historien Zosa Szajkowski, et plus de 500 si l’on inclut l’Afrique du Nord ; les publications en yiddish submergent celles en français (168 contre 134), avec un pic de 127 titres dans les seules années 1923-1939. Une première conclusion s’impose : la presse est un lieu de passage et de transition entre le monde d’où viennent les immigrants et leur nouvelle patrie. Tant que l’intégration, via souvent l’école, ne s’est pas réalisée, ils restent attachés aux journaux publiés dans leur langue.
La presse juive reflète également la diversité sociale et politique du judaïsme français. Pas moins de 22 catégories sont nécessaires à Z. Szajkowski pour en dresser une classification. De l’extrême droite à l’extrême gauche (bien plus représentée), des bundistes aux sionistes, de la lutte contre l’antisémitisme aux matières religieuses, de l’éducation aux publications pour la jeunesse, toutes les sensibilités et tous les mouvements associatifs sont représentés. C’est ce foisonnement que ce numéro d’Archives juives tente d’illustrer.
Sa lecture permet toutefois de réaliser la difficulté de ce type d’étude. En l’absence de sources, il s’avère presque impossible de citer pour cette presse des chiffres de diffusion fiables, de connaître son audience réelle et sa santé financière, le plus souvent fort fragile. Le mérite des auteurs n’en est que plus grand d’avoir brossé de ces publications un portrait réaliste à partir des seules informations fournies par la lecture des collections. Une prime s’en trouve donnée aux rares journaux ayant eu quelques années d’existence, les périodiques éphémères ne laissant par définition que peu de traces.
Parmi tous les titres évoqués ici, permettez-moi d’exprimer une tendresse particulière pour la presse des mouvements de jeunesse, dont Chalom est un excellent représentant. Outre ses mérites propres, ce titre, comme d’autres de ses contemporains, est une véritable pépinière de talents qui s’expriment dès les années 1920 et 1930, et qui pour certains, comme Wladimir Rabinovitch, illustreront la presse juive longtemps après la fin de la guerre.
Ceci met encore en relief un point propre à ces journaux juifs : la grande fluidité de ses auteurs, qui naviguent d’un titre à l’autre, parfois en se heurtant à des contradictions idéologiques. Il est patent que le métier de journaliste juif n’a que rarement procuré une position stable, et que la multiplication des piges avait aussi des causes financières. C’est également la raison pour laquelle l’entreprise de presse dans ce contexte est bien souvent l’aventure d’un homme seul ou d’une petite équipe.
Je crois avoir répondu à l’interrogation de départ. La presse juive est bien, malgré les difficultés de son étude, une source historique irremplaçable, qui témoigne de la multiplicité des expériences de la vie juive en France. À ce titre, elle méritait bien que notre revue lui consacre un dossier qui, nous l’espérons, encouragera de nouvelles recherches dans cet univers si passionnant.
J-C.Kuperminc
Sommaire
Dossier : Aspects de la presse juive entre les deux guerres
Introduction, par Catherine Nicault
Pas de résumé disponible pour l’instant.
La presse des anciens combattants juifs face aux défis des années trente, par Philippe-Efraïm Landau
A l’instar de leurs camarades de la Grande Guerre, les anciens combattants juifs fondent des associations dans lesquels ils défendent leurs intérêts et affirment leur patriotisme. Deux organisations, de sensibilité politique bien différente, sont créées au cours des années trente et diffusent leurs objectifs à travers un organe de presse : l’Association des engagés volontaires juifs (AEVJ) publie Le Volontaire juif (1931-1935), l’Union patriotique des Français israélites (UPFI) un Bulletin (1935-1938). Les deux journaux témoignent des contradictions de la société française et des tourments qui assaillent la communauté juive dès avant la seconde guerre mondiale.
/ The Press of the Jewish War Veterans facing the challenges of the thirties
Similar to their comrades of the First World War, the Jewish veterans founded associations dedicated to the defense of their own interests and the assertion of their patriotism. Two associations, with quite different political sympathies, are founded during the thirties with papers to express their purposes : the Association of the Jewish Volunteers (ACVJ) publishes The Jewish Volunteer (1931-1935), and the Patriotic Union of the French Israelites (UPFI) a Bulletin (1935-1938). Both these papers give evidence of the contradictions existing in the French society, and the torments which already befall the Jewish community previous to the Second World war.
Un cas singulier dans la presse des mouvements de jeunesse : Chalom (1925-1935), véritable mensuel d’information, par Catherine Poujol
Dans la presse de la jeunesse juive française, le mensuel Chalom apparaît comme un véritable organe d’information et non comme un simple bulletin à l’instar des autres publications de la jeunesse. L’article commence donc par le comparer aux périodiques d’autres associations comme Chema Israël, la Jeunesse libérale israélite et la Jeunesse juive, avant d’analyser Chalom, organe de l’Union universelle de la jeunesse juive (UUJJ), qui est d’abord et avant tout intéressée par le pacifisme et la défense des droits des Juifs dans leur pays de résidence. Aussi, devant d’une part les tentatives de son président et rédacteur en chef Aimé Pallière pour la rendre sioniste à partir de 1926 et d’autre part son incapacité à savoir accueillir les jeunes Juifs émigrés de la capitale, l’effectif de la section parisienne de l’UUJJ diminue-t-il rapidement. Mais Chalom est lu dans le monde entier et il est très écouté dans les sections lointaines. A Paris donc les cadres de l’UUJJ, qui sont aussi les rédacteurs de Chalom, informent les lecteurs étrangers de l’aggravation de la situation politique pour les Juifs en Europe et tentent d’alerter leurs frères des dangers qui les menacent contre l’avis des dirigeants du judaïsme français.
/ A Singular Event in the Press of the Youth Movements: Chalom (1925–1935), a Real Monthly Newspaper
Among the papers edited by the French Jewish youth organizations, the monthly Chalom appears as a real information review, different from a plain bulletin as edited by other youth organizations. This article first compares it to the periodicals of other associations such as Chema Israel, the Liberal Jewish Youth and Jewish Youth, before studying Chalom, the paper of the Universal Union of Jewish Youth (UUJJ), mainly dealing with peace and the defense of the rights of the Jews in the countries where they live. But, first because of the endeavours of its President and Head editor Aimé Palliere to induce a zionistic impulse from 1926, and also because of its inability to welcome young Jewish immigrants in Paris, the number of members of the Paris section of the UUJJ decreases rapidly, Still, Chalom is read all over the world, and is considered as giving useful advice by far away sections. From Paris, the leaders of UUJJ who are also the editors of Chalom, inform the foreign readers of the worsening of the political situation of the Jews in Europe and try to alert their brethren about the oncoming threats against them, and this without the agreement of the French Judaism.
Un titre israélite de province : La Revue juive de Lorraine (1925-1940), par Françoise Job
La parution de La Revue juive de Lorraine, qui existe toujours, a commencé en janvier 1925. Créée par un jeune étudiant en médecine, Robert Lévy, avec le soutien attentif du grand rabbin de Nancy, Paul Haguenauer, la revue ambitionne d’emblée de créer un lien entre les communautés de Lorraine par la diffusion de nouvelles diverses les concernant, et de proposer un riche contenu culturel, historique essentiellement, propre, pense-t-on, à rendre les israélites lorrains – car c’est à eux et rien qu’à eux que s’adresse la revue – plus conscients de leur identité juive française. Dans les années trente, la politique, pourtant exclue au départ, trouve à se glisser dans les pages consacrées à l’actualité du monde juif, surtout celles traitant de la question des Juifs immigrés et réfugiés d’Europe centrale et du sionisme. La revue cesse de paraître en juin 1940 pour renaître en octobre 1948 avec une nouvelle équipe qui semble peu informée de la vie antérieure du titre.
/ A provincial newspaper : The Jewish Review of Lorraine (1925-1940)
The Jewish Review of Lorraine, which still exists, first appeared in January 1925. Created by a young medical student, Robert Levy, with the thoughtful support of Paul Haguenauer, the Chief Rabbi of Nancy, this review seeks from the start to create a link between the various communities in Lorraine through the publishing of news concerning each one and all, and to offer a rich cultural content, mainly historical, intended, according to its conception, to make the Lorraine Israelites – the review was concerned with them only – actually aware of their French identity. During the thirties, although they were not dealt with in the first numbers, begin to appear through the pages giving information about the present Jewish life, mostly those dealing with the problem of the Jewish immigration and the Jewish refugees from Central Europe, and Zionism. The review stops being edited in June 1940 and starts again in October 1948 with a new staff which does not seem to be aware of the past of the review.
Parizer Haynt et Naïe Presse, les itinéraires paradoxaux de deux quotidiens parisiens en langue yiddish, par Aline Benain et Audrey Kichelewski
Par une étude attentive des collections conservées de ces deux journaux jusque dans les détails les plus concrets et les plus infimes, les auteurs définissent leur organisation et leur fonctionnement : leurs rédactions (locaux et journalistes), leurs sources de financement et leur diffusion, les caractéristiques de leur lectorat avec ses attentes et les réponses apportées par les journaux dans leurs diverses rubriques, leurs objectifs et le plus ou moins grand décalage entre ces objectifs et le résultat obtenu. Ainsi, que ce soit le Parizer Haynt, tourné vers le passé polonais des immigrants avec une nette coloration sioniste, ou la Naïe Presse, courroie de transmission du Parti communiste français, ces deux journaux ont facilité et accéléré l’assimilation à la France d’immigrants par le canal de la seule langue qu’ils connaissaient bien, le yiddish.
/ Parizer Haynt and Naïe Presse, paradoxical routes of two Paris daily newspapers in Yiddish
Through a thorough study of the collections of archives of these two newspapers, down to the tiniest and most concrete details, the authors reach a definition of their organization and management : the editing (sites and journalists), financial sources and edition, characteristics of their readers, according to their questions and the answers given in the various articles, their purposes and the more or less important gap between them and the results gains. To sum up, the Parizer Haynt concerned with the polish past of the immigrants and with a clearly defined Zionism, or the Naïe Presse, the mouthpiece directed toward the immigrants of the French Communist Party, these newspapers helped and sped up the assimilation of immigrants through the sole channel of a language known to all of them : the yiddish language.
Quand Vladimir Jabotinsky était parisien. Le Rassvet, revue sioniste-résisionniste en langue russe, par Simon Markish
De 1924 à 1934, Paris est le port d’attache personnel du leader sioniste russe Vladimir Jabotinsky, le siège de l’Exécutif de l’Union révisionniste qu’il vient de fonder, et surtout le lieu de publication de son organe, Rassvet. Du contenu du périodique l’auteur propose une analyse politique et littéraire qui souligne à la fois les talents polémiques de Jabotinsky qui y collaborait très activement, et ses qualités littéraires qui mériteraient que ces textes soient mieux connus. Cependant la localisation de la revue à Paris semble sans effet sur les thèmes traités : reflet des préoccupations de son principal rédacteur, elle apparaît ici uniquement occupée de l’actualité sioniste, russe, polonaise et palestinienne.
/ When Vladimir Jabotinsky lived in Paris. The Rassvet, a revisionist-Zionist review written in Russian
From 1924 up to 1934, Paris is the personal home-base of the Russian Zionist leader Vladimir Jabotinsky, the Executive head-office of the Revisionist Union which he had just founded, and utmost, the editing place of its review Rassvet. Simon Markish offers a political and literary study of the contents of this periodical, which underlines both the gifts as a polemist of Jabotinsky who contributed very actively to the periodical, and his literary talents which could be worth being known more widely. However, the editing place of the review in Paris seems to have had no influence whatever upon the subject-matters dealt with : reflecting the main causes of concern of the editor, it appears that only the Zionist, Russian, polish and Palestinian news mattered to him.
Mélanges
Aux débuts de la communauté moderne de Clermont Ferrand, par Anne Zink
Ce groupe juif, déjà relativement étoffé en 1808, forme une communauté à la fois originale et isolée. Rattaché au lointain consistoire de Bordeaux, éloigné des synagogues (la plus proche est à Saint-Étienne), dépourvue de rabbin, elle se structure autour d’un colporteur devenu riche négociant, Israël Wael, véritable pilier de la vie juive locale. Ce n’est cependant qu’après sa mort en 1838 que la communauté est pourvue d’une synagogue, qu’en 1854 qu’elle obtient un poste salarié de l’Etat pour son ministre-officiant, que vers 1880 qu’elle a un cimetière attenant au cimetière communal. Communauté réduite et pauvre, majoritairement ashkénaze, elle est séparée par un abîme sociologique du consistoire de Bordeaux, fleuron de l’aristocratie séfarade ; cependant leurs rapports, bien que peu fréquents, sont tout à fait courtois. Les maires et les préfets ne se départissent pas d’une attitude bienveillante, qui joue à la fois comme cause et comme conséquence d’une insertion sans problème des membres de la communauté dans la cité.
/ The beginnings of the modern community in Clermont-Ferrand
This Jewish group, already somewhat bulky in 1808, remains a community both particular and isolated. Depending on a distant Bordeaux Consistory Far from any synagogue (the nearest ore being that of Saint Etienne) deprived of its own rabbi, it develops a structure around a peddler who became a wealthy wholesaler, Israel Waël, the actual center of the local Jewish life. It was nevertheless after his death in 1838 that the community had its own synagogue, and only in 1854 it obtained a state-appointed rabbi and only about 1880 that it had a cemetery adjoining the communal one. A poor and small community, mainly of Ashkenazi origin, a sociological gap maintains it apart from the Bordeaux Consistory, typical of the sefardi aristocracy ; however their relations, in spite of being infrequent, remain courteous. The mayors and the prefects behave with benevolence towards it, and this is altogether the reason and the consequence of an easy integration of the members of this community in the city.
Les paradoxes des anarchistes face au sionisme et à la naissance de l’Etat d’Israël, par Sylvain Boulouque
En dépit de l’internationalisme, du pacifisme et de l’hostilité du courant libertaire à l’Etat comme forme d’organisation sociale, certains anarchistes, juifs souvent mais pas toujours, ont montré un intérêt compréhensif au sionisme – le cas de Bernard-Lazare n’est pas unique – et à la naissance de l’Etat d’Israël. Certains d’entre eux partent même s’installer dans des kibboutzim, qui représentent pour eux un modèle de société idéale. L’objet de l’article, au-delà de ces constats, est de parvenir à comprendre comment ces anarchistes juifs parviennent à conjuguer leur identité et leur engagement idéologique.
/ The paradoxes of Anarchists facing Zionism ant the birth of Israel
In spite of their tendency towards internationalism and pacifism as a libertarian trend and their antagonism to state as the sole figure of social organization, some anarchists, often Jewish ones but not always, registered a comprehensive interest for Zionism – Bernard Lazare is not the only instance – and the birth of the state of Israel. Some of them even leave their country to settle in « kibboutzim » which they consider as the model of an ideal society. Beyond these statements, this article tries to reach an understanding of how these Jewish anarchists achieve this combination between their own identity and their ideological commitment.
La politique antijuive de Vichy en Afrique occidentale française, par Ruth Ginio
L’attitude de l’administration coloniale envers la poignée de Juifs présents en AOF sous Vichy offre une figure emblématique et quasi caricaturale de l’administration vichyste devant le » problème juif « . Elle fit preuve d’une obstination légaliste à faire appliquer les lois antijuives jusque dans leurs moindres dispositions. Le rétablissement des Juifs dans leurs droits y fut entravé par l’administration sous Giraud comme elle le fut en Afrique du Nord et ne devint effectif qu’après la victoire définitive, en 1943, de De Gaulle sur son rival.
/ The anti-Semitic policy of Vichy in French Western Africa
The attitude of the colonial administration towards the few Jews who lived in French Western Africa under Vichy government symbolizes and, so to speak, is the caricature of the Vichy administration behaviour as concerns the « Jewish problem ». It proved stubbornly legalistic in the enforcement of the anti-Semitic laws down to the tiniest details. Regaining their rights by the Jews was hindered by Giraud Administration in the same way as it was in North Africa, and could only take effect when De Gaulle triumphed over his rival in 1943.
Archives
- De l’usage des archives privées. Entre l’Allemagne et la France : itinéraire d’un juif lorrain (1892-1968), par Monique Lévy
- L’Institut méditerranéen Mémoire et archives du judaïsme (IMMAJ) à Marseille : au service d’un patrimoine ressuscité, par Dan Jaffé
Dictionnaire
- Simon Behr, par Françoise Job
- Marcel Gradwohl, par Mathias Orjekh
- Simon Kanoui, par David Nadjari
- Darius Milhaud, par Georges Jessula
- Raymond Winter, par Mathias Orjekh
Lectures
- La Cloche de dix heures. Radiographie d’une rumeur, par Nicole-Lise Bernheim (Aline Benain)
- Regards sur la culture judéo-alsacienne. Des identités en partage, collectif sous la direction de Freddy Raphaël (Monique Lévy)
- L’Antisémitisme de gauche au XIXe siècle, par Marc Crapez (Sylvain Boulouque) , collectif sous la direction de Marc-Olivier Baruch (Monique Lévy)
- Paris – Eine neue Heimat ? Jüdische Emigranten aus Deutschland, 1933-1939, par Julia Franke (Françoise Kreissler)
- Varian Fry. Du refuge à l’exil, collectif ( Katy Hazan)
- L’Etoile rouge de David. Les Juifs communistes en France, par Jacques Frémontier (Sylvain Boulouque)

